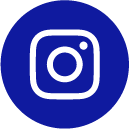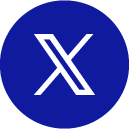Quelle prétention est-ce donc que de « créer des publics » ? Nul ne « crée » rien de rien. Et les « publics » sont des entités auxquelles on s’adresse en espérant avoir la chance (de plus en plus improbable) de pouvoir attirer leur attention. « Il y a un public pour cela », disent les agences de communication. Le problème est de le trouver, peut-être de le rassembler, mais certainement pas de le « créer ». Les canaux de communication alimentent les esprits des gens, qui leur préexistent. Pourquoi diable dirait-on que le tuyau d’arrosage « crée » la tomate ? D’un autre côté, la serre ne crée pas la tomate, mais la permet (en Bretagne par exemple) ?
Créer des publics est peut-être impossible, voire absurde, mais cela n’en est pas moins nécessaire à l’heure où nous vivons. Une certaine conception consensuelle de la communication – à la fois largement partagée et de bon sens – nous empêche de voir ce qui nous étouffe et ce qui pourrait nous aider à dégager d’autres perspectives d’avenir. Une conception alternative de ce que nous font nos media de communication est en germes depuis déjà bien longtemps, à laquelle il convient de faire davantage de place. Essayons d’en rassembler quelques fils épars, et d’en esquisser la forme générale dans les quelques pages qui suivent, sur la question de l’improbable création de publics.
Qu’est-ce qu’un public ?
Commençons par rappeler quelques distinctions utiles. Gabriel Tarde proposait dès l’aube du XXe siècle une distinction entre les foules (celles des stades ou des manifestations de rue), rassemblées physiquement en un même lieu au même moment et pouvant donc s’affecter mutuellement de façon mutuelle et immédiate, et les publics (ceux des lecteurs de journaux ou des spectateurs de télévision), dont les individus font l’objet d’une adresse asymétrique (ils ne peuvent pas répondre) qui leur apporte les mêmes messages reçus de façon isolée, chacun sachant qu’il fait partie d’une masse dont il ne perçoit pas les réactions présentes.
Un débat important a opposé certains intellectuels états-uniens quelques décennies plus tard, au cours duquel Walter Lippmann proposait une image de publics fantômes, abreuvés d’informations trop complexes pour eux et qu’il importe donc de leur prémâcher, contre quoi John Dewey développait l’image de publics enquêteurs, constitués par leur curiosité active, collective et investigatrice autour de difficultés élevées par eux au statut de « problèmes publics ».
Au début des années 2000, Michael Warner publiait un essai très synthétique avançant une définition à la fois inspirante et consensuelle des publics (qu’il distinguait explicitement du public) articulée en sept thèses.
1- « Un public est auto-organisé » (50) : s’il peut être partiellement suscité ou contraint par des institutions préexistantes (puissances gouvernementales ou commerciales), une part essentielle de sa dynamique relève d’une circularité à travers laquelle il s’ajuste à lui-même de façon « autotélique », comme s’il avait sa fin en soi.
2- « Un public est une relation entre inconnu·es [strangers] » (55) : la différence entre un cercle d’amis et un public tient non seulement à ce que ce dernier inclut des gens qui ne se connaissent pas entre eux, mais surtout à ce qu’il cherche constitutivement à accroître le nombre de ses membres, à y intégrer des personnes qui y sont encore étrangères.
3- « L’adresse d’une communication publique est simultanément personnelle et impersonnelle » (57) : en se destinant à la fois à nous et à d’autres encore extérieur·es à ce « nous » actuel, ce qui circule dans un public risque toujours d’en ébranler quelque peu les certitudes identitaires, participant ainsi d’une dynamique de redéfinition et de recomposition permanente des frontières, des oppositions et des dominations entre groupes sociaux.
4- « Un public est constitué par l’attention qui s’y investit » (60) : la vie d’un public n’est pas seulement nourrie, depuis l’amont, par les « contenus » qui lui sont adressés, mais tout autant, depuis l’aval, par les « levées d’attention active » (active uptake) que ces contenus parviennent à susciter.
5- « Un public consiste en l’espace social créé par la circulation réflexive des discours » (62) : même si la communication relève d’une structure asymétrique (comme dans le cas de la radio ou de la télévision), il n’y a véritablement de public que là où de nouvelles rencontres peuvent s’opérer entre des phrases, des idées, des images, des récits et des personnes dont la circulation ne saurait être circonscrite a priori, et dont les éclairages et clashs réciproques sont la source d’une réflexivité imprévisible.
6- « Les publics agissent historiquement selon la temporalité des circulations qui les alimentent » (68) : depuis l’émergence de la presse périodique au XVIIIe siècle, cette imprévisible réflexivité des publics s’est organisée autour de certains rythmes ponctuels synchronisant les vies collectives selon la périodicité des revues mensuelles, des journaux quotidiens, des bulletins de nouvelles, des mises à jour des pages web ou des envois de tweets.
À ces caractéristiques définissant à la fois les conditions d’existence et les puissances d’agir des publics, Michael Warner ajoutait un dernier trait, qui mérite de retenir particulièrement notre attention ici : 7° « Un public est un faiseur poétique de mondes [a public is poetic world-making] » (82). Les différents éléments de la définition – auto-organisation, circularité, autotélisme, agrégation d’étrangers, brouillage des adresses et des identités, énergisation attentionnelle, émergence de réflexion collective, rythmisation – mettent en place les conditions d’une auto-créativité sociale dont les publics sont les lieux privilégiés. Leur poiésis propre relève de la création de mondes, mais ce sont aussi bien les publics eux-mêmes qui relèvent d’une création quasiment surnaturelle, même si « la magie par laquelle le discours parvient à faire advenir un public par conjuration [conjures up a public into being] reste, bien entendu, imparfaite du fait que tout ce qu’elle présuppose » comme conditions de félicité (75). « Cette dimension performative du discours public se trouve pourtant régulièrement occultée » (75) par nos conceptions partagées de la communication, qui tendent à considérer les publics comme composés de personnes préexistantes, auxquelles il ne s’agirait que d’apporter quelques informations ou divertissements supplémentaires.
Contre-publics, audiences, lectorats
Cette faculté auto-poétique des publics apparaît pourtant bien dans l’émergence régulière de ce que Michael Warner qualifie de « contre-publics », catégorie qu’il élabore en dialogue avec celle de contre-public subalterne proposée par Nancy Fraser. Celle-ci désignait ainsi des « arènes discursives parallèles où des membres de groupes sociaux dominés inventent et font circuler des contre-discours, qui leur permettent à leur tour de formuler des interprétations oppositionnelles de leurs identités, intérêts et besoins ». L’auto-créativité – pas forcément « spontanée » – des publics se manifeste clairement dans la capacité de tels groupes sociaux subalternes à se « conjurer à l’existence », le rôle joué par une activité de « publication » au sein de cette conjuration auto-poétique étant bien sûr le point qu’il faudra préciser.
Deux distinctions doivent pourtant encore être ajoutées à notre boîte à outils de faiseurs-de-mondes par création de publics. D’abord une distinction d’échelle quantitative, qui entraîne d’importantes différences qualitatives. On peut réserver le terme d’audience pour désigner des publics massifiés, tels que les médias audio-visuels du XXe siècle ont pu en donner le modèle, par exemple lors du pic de concentration attentionnelle atteint le 9 septembre 1956, quand le passage d’Elvis Presley au Ed Sullivan Show de CBS attira 82,6 % des parts de marché d’audience à l’échelle des USA. Tandis que les audiences peuvent se mesurer en centaine de millions, voire en milliards, de spectateurs, le public d’une revue comme Multitudes peut se réduire à quelques très petites centaines d’abonnements, de ventes en libraires et quelques milliers de clics sur Cairn ou sur multitudes.net.
Aborder les publics en termes purement chiffrés, et d’une façon qui les plaque sur le seul nombre d’individus ayant souscrit un abonnement à une revue ou acheté un ticket d’entrée, fait toutefois violence au brouillage d’adresse ainsi qu’à l’imprévisible étrangeté des personnes assemblées, dont Michael Warner faisait deux caractéristiques essentielles de sa définition. C’est le poète et théoricien Christophe Hanna qui prévient de tels dangers en nous invitant à distinguer deux termes.
Il y a d’une part le lectorat d’un livre, qui peut en effet se mesurer à celles et ceux qui l’ont acheté, emprunté, téléchargé dans la visée d’en parcourir (plus ou moins impatiemment) les pages de leur regard. Il y a par ailleurs le public de ce même livre, qui ajoutera à ce petit nombre de lecteur·es toutes celles et ceux qui auront pu avoir entendu parler du livre par un ami ou à travers un entretien radiophonique, qui auront été mobilisé·es pour sa production ou sa vente (non sans y avoir peut-être jeté un coup d’œil furtif au passage), qui en auront vu une adaptation transmédiale, ou qui en auront apprécié une image ou une idée reprise à la volée par une tierce personne. Même si nous avons davantage de peine à discerner les contours d’une entité aussi diffuse, elle nous approche sans doute davantage du mode d’existence réelle des publics, qui ressort bien, après tout, d’activités et de phénomènes de « diffusion ».
Les lois de production des publics « démocratiques »
Munis de cette boîte à outils, nous pouvons affronter le blocage principal qui obture notre avenir commun : nous subissons nos publics – au sens où leur coagulation relève actuellement de lois et de tendances qui handicapent notre puissance d’agir collective. Il ne sert à rien de se plaindre que « les gens sont cons » chaque fois que se fait élire un politicien qui aura surfé sur les affects les plus malodorants. Ce ne sont pas « les gens » qui élisent les politiciens. Ce sont des publics. À savoir : des auto-organisations affectives collectives, intrastructurées par certains régimes de circulation de contenus et par certains flux financiers, au sein de certains formatages canalisants, autour de certains attracteurs d’attention plus ou moins irrésistibles pour le commun des mortels.
Quelle est donc l’opération très particulière produite par les joutes électorales, dont les retours rituels scandent périodiquement ce que nous nous obstinons, contre toute évidence, à nommer des « démocraties » – comme si c’était « les gens du peuple » (le demos, the people) qui votaient, plutôt que des publics ? Cette opération transforme éphémèrement des publics hétérogènes en un public (faussement appelé « le peuple »), réputé assez homogénéisé, assez nombreux et assez représentatif pour être investi du droit de propulser telle équipe plutôt que telle autre dans les palais du gouvernement.
Comment donc produisons-nous ce public, dont notre sort commun dépend en partie ? Très mal – parce qu’avec la plus grande nonchalance. À quelques détails près, mineurs quoi que nullement insignifiants, dont se chargent le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ou les lois régissant le financement des partis politiques, nous nous fions à seulement deux grands principes cardinaux. Le premier principe, fièrement claironné, est celui de la liberté d’expression : sauf cas limites (vie privée, diffamation, incitation à la haine, secret des affaires), la démocratie sera suffisamment protégée dès lors que nous aurons scrupuleusement veillé à permettre à chacun·e d’exprimer ce que bon lui semblera, dans le périmètre (remarquablement large) de ces limites minimalistes. Le deuxième principe va généralement sans dire : c’est celui de l’autorégulation du marché des idées et du supermarché des images par la loi de la compétition marchande, telle que la régit l’économie de l’attention. Tout le monde a certes le droit de s’exprimer. Mais le pouvoir d’être effectivement entendu d’un public se trouve très inégalement réparti et, dans la mesure où les financements publicitaires jouent un rôle central dans nos économies médiatiques, la marchandisation de l’attention y joue un rôle (intra)structurant.
Le droit du public à entendre
Bien entendu, dans un pays comme la France, de nombreuses formes de subventions publiques s’efforcent de desserrer l’étau commercial par lequel seraient étranglés la plupart des médias, s’ils étaient placés sous les seules lois de la liberté d’expression et de la compétition marchande – ce qui est bien davantage le cas aux USA, avec les conséquences que l’on sait. Ces correctifs indispensables, mais structurellement marginaux, se justifient généralement au nom d’un troisième principe, fréquemment identifié à la noo-diversité d’opinions (où le noos tiré du mot grec désignant « l’esprit » résonne opportunément avec le nous de notre sujet pluriel). Il ne suffit pas de laisser tout le monde s’exprimer, acheter et vendre. Il faut aussi veiller à ce qu’aucune voix ne se trouve en position de monopoliser la parole.
La limite d’une telle approche est de se cantonner du seul côté d’une économie de l’offre. C’est toujours du pôle de l’expression qu’on se préoccupe, comme s’il suffisait de produire pour rencontrer un besoin, comme s’il suffisait de multiplier les adresses pour hameçonner des publics, comme s’il suffisait de parler pour être entendu. C’est à un renversement de perspective déplaçant radicalement la question du côté de la réception et des publics que nous invite un courant de réflexion récent, qui bricole un pont inattendu mais stimulant entre critique politique et sound studies.
Kate Lacey en a donné une bonne formulation en proposant de « mettre en balance l’idéal normatif de libre expression avec une liberté d’écouter, elle aussi normative, qui inclurait à la fois une responsabilité et un droit d’écoute » : « alors que la liberté d’expression est un droit orienté vers l’individu, il y a une ‘liberté d’écouter’ [a freedom of listening] qui, par contraste, est inhérente à l’espace situé entre les individus, et qui vise précisément à garantir le contexte au sein duquel la liberté d’expression peut opérer, non pas en tant que simple parole, mais en tant que communication ».
C’est une telle liberté d’écouter qu’élabore Mike Ananny au nom d’un droit du public entendre (a public right to hear) – un droit qu’il importe de conférer au public comme tel, sans le réduire aux droits individuels des personnes qui le composent, et un droit qui doit d’ores et déjà être pensé à une échelle mondiale. Nous n’échapperons pas au besoin de « faire public » à l’échelle de la planète. Pour le moment, la magie hautement commercialisée des coupes du monde de football y parvient plus aisément que les miteuses réunions de la COP consacrées au dérèglement climatique, même si la figure de Greta Thunberg et les grèves des lycéen·nes donnent l’espoir d’inverser cette inertie.
Un droit du public à entendre implique de réviser fondamentalement les prémisses à partir desquelles nous concevons la communication, la politique et la démocratie. Le plus important n’est pas forcément de nous époumoner à parler, mais bien de nous doter des moyens de nous entendre. Au lieu d’identifier l’activisme à la parole, nous pourrions subordonner l’action à l’écoute, donc (paradoxalement !) au silence. Et au lieu de nous épuiser à vouloir émettre les bons signaux – plus attirants, plus vrais, plus fidèles ou plus politiquement corrects que ceux du voisin – nous pourrions consacrer davantage d’énergie à cultiver notre capacité collective d’écoute envers ce qui se dit déjà assez bien, mais que nous ne nous rendons pas collectivement capables d’entendre.
Comme le martèle Mike Ananny tout au long de son livre, ceci n’est pas (seulement) une affaire de disposition personnelle et d’ouverture d’esprit. Ni droits individuels, ni éthique personnelle ne suffiront. C’est avant tout un problème d’infrastructure, c’est-à-dire « de séparations et de dépendances sociotechniques ». Les individus devraient bien entendu avoir le droit à ne pas écouter, autant que le droit à entendre. Les publics qu’ils forment ensemble subsument toutefois ces droits individuels au sein de dispositifs communs qui conditionnent fortement leurs façons d’écouter et d’entendre, selon l’emplacement et la nature des séparations et des dépendances qui structurent ces dispositifs.
À l’heure où le gouvernement français impose la fusion de Radio France et de France Télévision (abolissant une séparation), Sylvain Bourmeau rappelait la différence de structure, de nature et d’effet entre le mode opératoire de la première, qui ne reçoit ses résultats d’audience qu’une fois tous les trois mois, et celui de la seconde, qui y soumet ses journalistes sur une base quotidienne (resserrant une dépendance). C’est à l’échelle de ce genre de différences de structures, a priori mineures mais aux effets considérables, qu’il s’agit d’implémenter un droit du public à entendre – et c’est à partir d’elles qu’il convient de concevoir la possibilité de créer de bons publics.
Instaurer des publics
La capacité à créer des publics – des publics désirables : mitoyennement attentionnés, mondialement solidaires, écologiquement responsables, intellectuellement et esthétiquement curieux – ne relève nullement du vain rêve. D’autres l’ont fait. Certains le font. Rien ne nous interdit de nous y mettre avec plus de conviction. Comme le remarquait pertinemment Anne Querrien durant la préparation de ce dossier de Multitudes, le XXe siècle a connu de nombreuses aventures de création de publics couronnées d’un succès jamais complet ni pérenne – les publics sont diffus, dissolus et passagers – mais néanmoins encourageant. Qu’ont fait Jean Vilar avec le Théâtre National Populaire et le Festival d’Avignon, André Bazin avec ses ciné-clubs et les Cahiers du cinéma, sinon travailler à créer des publics ?
Plus près de nous, que font Anne-Laure Blusseau, Christophe Hanna, Olivier Quintyn et le collectif d’auteurs réunis autour des Questions Théoriques, sinon bricoler des dispositifs constituant des works (au sens d’œuvres) dont le work (au sens de travail) consiste à générer/susciter/coaguler des publics alternatifs autour de problèmes déjà ou non encore identifiés comme publics ? Que sont parvenus à faire Alain Damasio et Mathias Echenay avec La Volte, sinon patiemment et amoureusement créer un incroyablement large public, qui s’oriente désormais dans la vie en référence aux idées, aux formulations et aux sensibilités advenues à l’être à travers Les furtifs ou La Horde du Contrevent ? Que documente le bel article d’Emmanuelle Cadet dans le dernier numéro de Multitudes, sinon la façon dont on peut construire un public d’amateur·es d’art et de connaisseur·es de musées en invitant des jeunes de quartiers populaires à s’emparer de la question des restitutions d’objets mal acquis lors de la colonisation ?
De tels exemples, qu’il faudrait multiplier par des milliers d’autres, font bien apparaître la double couche de création des publics. C’est certes le mérite des grandes œuvres que de faire surgir de nouveaux publics insoupçonnés jusqu’à elles. Mais ces surgissements ne seraient pas possibles sans l’aménagement préalable de terrains propices à leur émergence et à leur accueil. Maisons d’édition, maisons de la culture, séminaires pirates, éducation populaire, associations d’amateurs, subventions : les publics désirables ne sortent pas tout faits de la cuisse de Jupiter. Les publics se cultivent – en élaborant et en alimentant ce qu’une inspiration guattarienne pourrait baptiser d’« agencements collectifs d’attention ».
Ces exemples font par là-même sentir l’inadéquation du terme de « création » pour désigner ce qui s’y joue vraiment. Ce serait bien plutôt la notion d’instauration, empruntée à Étienne Souriau, qui permettrait d’approcher le caractère à la fois improbable, fragile, tâtonnant, humble et néanmoins décisif de ce qui est en jeu. Rien, bien entendu, n’est créé de rien. C’est plutôt un germe, tombé sur le sol on ne sait d’où, qu’on aide à prendre forme, en l’enfonçant un peu, en l’arrosant ou en le réchauffant au bon moment pour qu’il prenne racine. C’est bien une affaire de tuyaux et de serres, et d’attention à l’attention.
Prestidigitalités numériques et magies présentielles
Cette instauration de publics a eu des exemples particulièrement spectaculaires depuis vingt ans dans le domaine des communications numériques. Blogueurs, influenceuses, Tweeters, YouTubeurs, plateformes de distribution en streaming, jeux vidéo en ligne, mais aussi tutoriaux de réparation, séances d’AMSR, séries intégralement embarquées sur réseaux sociaux (SKAM) : tout cela a coagulé autour de soi des nouveaux publics, qui auraient été inimaginables il y a à peine vingt ans. Lancé en mars 2012, le site UpWorthy.com, monté par Eli Pariser et Peter Koechly pour relayer des nouvelles allant dans un sens progressiste, est passé, en une année, de l’inexistence à un public accumulant 80 millions de visiteurs (à l’heure où le New York Times n’en comptait « que » 20 millions).
À l’heure où tout le monde dénonce les capacités de nuisance des réseaux numériques (surveillance, manipulation, consumérisme), il est bon de rappeler que l’activité d’instauration des publics y trouve un champ d’exercice encore largement inexploré, et que notre avenir se joue en partie dans notre capacité à savoir en actualiser certaines virtualités favorables. Or, comme l’analyse admirablement David Karpf, le succès (certes éphémère) d’UpWorthy s’est fondé précisément sur une capacité « d’écoute digitale » (digital listening), qui commence par se taire, afin de prêter l’oreille à ce qui circule déjà sur internet, qui le reformate en enregistrant les réponses collectées par des procédures massives d’A/B testing, et qui, au terme de cette écoute attentive, l’ajuste à ce qui paraît être les attentes potentielles et les sensibilités virtuelles en germe dans le public. UpWorthy est parvenu à faire pencher à plusieurs reprises la balance des décisions politiques en ne disant rien (qui vienne de soi), mais en se contentant d’écouter pour relayer (après avoir reformulé).
Dans de tels cas, l’exploration des puissances de la digitalité algorithmique prend rapidement des allures de prestidigitation excédant et défiant nos attentes les plus raisonnables. Nul n’a encore pu déterminer ce que peut un corps numérique ingénieusement inséré dans un réseau. Nul ne sait quel public peut en émaner – pour le meilleur comme pour le pire.
Mais l’instauration de publics inédits n’est nullement le privilège des « nouveaux media » numériques. Comme l’illustrent plusieurs contributions à ce dossier, aux limites des micro-publics et des petites foules, les magies de la présence scénique n’ont rien à envier aux surprises des prestidigitalités algorithmiques. Elles gagnent parfois en intensités ce qu’elles concèdent en taille. Dans ce domaine aussi, les sound studies peuvent faire office de guide. En arpentant quatre figures adjectivales d’agentivité sonique – l’acousmatique, l’overheard, l’itinérant et le faible – Brandon LaBelle aide ici à identifier d’« improbables publics » (unlikely publics) qui émergent autour et en marge d’internet, publics qui restent encore peu compris et peu mobilisés.
Ces quatre figures soniques sont toutes affectées d’un manque, d’une limitation – d’une absence rendue sensible par la magie présentielle. Si elles sont vectrices d’agentivité, c’est précisément parce qu’elles placent leurs publics dans des dispositifs où ils échouent à voir ou à entendre ce qui d’habitude est mis en saillance pour attirer leur attention conformément à leurs attentes. Les séparations et les dépendances qui s’y mettent en place, en frustrant les attentes, suscitent un sentiment d’incomplétude, et des dynamiques de partage de ces incomplétudes. Le meilleur moyen pour ne plus avoir à subir nos publics est peut-être de les rendre actifs en cessant de devoir les combler.
Hapticalité et médias souverains
Les réflexions qui précèdent débouchent sur deux horizons vers lesquels l’ambition de créer des publics peut tendre – avec la perspective de s’y dissoudre. D’un côté, la dissolution des attachements dans des réseaux sociaux distendus, évanescents et chaotiques, semble entraîner par réaction un besoin de coaguler des publics de proximité. L’énergisation passe par les effets de foule propres au contact réciproque de milliers de corps partageant un même lieu (stades de sport, concerts, festivals, spectacles scéniques, mais aussi manifestations de rue ou flash mobs). Cela passe aussi par des rencontres d’échelles plus modestes, à l’occasion desquelles un public censé être composé d’inconnus anonymes, isolés les uns des autres, met en scène un côtoiement porteur d’une promesse de familiarité potentielle, à l’occasion d’une projection de film ou d’une proposition d’art relationnel.
Les publics traditionnels étaient censés mobiliser les sens de l’ouïe et de la vue, pour goûter des mots, formes, couleurs, rythmes et mélodies. Ces publics de proximité paraissent surtout réunis pour se frotter les uns contre les autres, pour se sentir, pour se toucher et, si tout se passe pour le mieux, pour être ainsi conduits à se fréquenter plus durablement. Cet horizon d’hapticalité fait de la création de publics un moment de formation de communautés réelles – des communautés de partage et de terrain, des communautés particulières composées d’associations de personnes privées – bien plus concrètes que la « citoyenneté » formelle promise par les pensées de la « sphère publique ».
D’un autre côté – apparemment opposé, mais avec des possibilités d’étonnantes convergences – les explorateurs les plus aventureux des nouvelles friches numériques ont depuis toujours nourri la flamme des médias souverains, ces dispositifs de communication dont la particularité est de s’émanciper de toute visée d’audience. Comme le précise ici la contribution (déjà ancienne) d’Eric Kluitenberg, ces médias sont « souverains » dans la mesure exacte où ils refusent de s’asservir à quelque public prédéfini que ce soit. En amont des théoriciens et activistes hollandais qui ont formulé la revendication de médias souverains (autour de Geert Lovink) à la fin des années 1990, c’est le geste fondamentalement auto-constituant de l’art d’avant-garde du XXe siècle qui se retrouve ici. Loin de relever d’un mépris du public ou d’un dédain envers les masses, cette attitude veut au contraire croire en la possibilité de publics incomparablement plus curieux, aventureux, exigeants et intelligents que ne le postulent les agents de communication qui sommeillent en nous. La leçon des médias souverains mérite d’éclairer l’ensemble de ce dossier : les seuls publics valant vraiment la peine d’être créés sont ceux qui n’auront pas pu être anticipés.