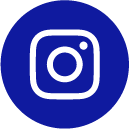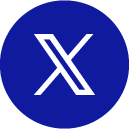Le DIU ArTeC+, diplôme post-master en un an, prépare les étudiant‧es aux gestes de la recherche et de la création, pour les aider à préciser et consolider un projet artistique ou de doctorat en recherche-création.
2025-2026
TERRAINS MOUVANTS

Crédit image : Mathilde Roussel et Matthieu Raffard
« Moi je parle pour ces visages » affirme François Bon.
Le programme de DIU de l’année 2025-2026 s’adresse à des étudiant·es qui souhaitent structurer un projet de recherche ou qui veulent réaliser un parcours doctoral. Dans ce cadre, nous aimerions tout au long de cette année penser la notion d’enquête en sciences sociales et en art depuis la spécificité des terrains mouvants.
Enquêter sur un terrain mouvant, cela veut dire plusieurs choses. Premièrement, cela veut dire renoncer à l’idée de pouvoir parfaitement circonscrire son domaine d’investigation (Morton). Deuxièmement, cela veut dire accepter d’être pris·es dans les plis du terrain sur lequel on travaille (Favret-Saada). Et, troisièmement, cela veut dire développer une éthique particulière pour respecter la fragilité des phénomènes que l’on étudie (Pascal Nicolas Le Strat).
Face à une mémoire collective involontairement ou délibérément trouée, de nombreux artistes et chercheur·euses tentent de réparer les oublis, de combler les injustices, ou de prendre soin des histoires abimées. Ainsi, Kamel Daoud, Adèle Yon ou Alexandra Saemmer tentent de comprendre la structure d’un trauma passé sous silence. De leur côté, les militant·es de Forensic Architecture ou du collectif RYBN essaient de reconstituer ce que le pouvoir militaire ou financier a camouflé, tandis que Mathieu Kleyebe Abonnec tente d’actualiser un récit colonial trop souvent laconique.
À travers leur travail, à travers leurs enquêtes, ils ou elles nous montrent la voie d’une méthodologie possible pour évoluer dans les méandres d’un terrain mouvant.
Le terrain met l’écrivain·e, le·a chercheur·euse et l’artiste devant le caractère situé de sa position (Haraway). Tout prélèvement de traces sur un terrain sensible implique une réflexion éthique et politique sur les enjeux de cette opération. Lorsque le terrain « résiste », comme l’exprime le sociologue Michel Messu, il faut alors savoir remettre du jeu dans nos processus d’enquête. Lorsque les traces, les témoignages et les indices sont parcellaires, il nous faut apprendre comment traiter les brèches et parfois avoir recours à la fiction pour redonner de la voix aux visages qui cherchent à prendre, ou reprendre la parole.
L’entremêlement des réalités lors d’un écocide, la matérialité complexe des objets technologiques, la sensibilité multidimensionnelle des questions queer ou bien encore l’effritement des mémoires liées aux violences exercées par des systèmes de pouvoir : de nombreux objets de recherche contemporains peuvent être envisagés comme des terrains mouvants. Dans ces conditions, l’enquête de terrain n’est pas qu’un simple moment de collecte de preuves, de palpation de symptômes ou de chiffrage des effets, mais c’est aussi une tentative de faire corps avec la réalité que l’on investigue. Dans ce corps à corps, il faudra savoir trouver sa place sans instrumentaliser.
Il faudra faire preuve de tact, il faudra savoir tâtonner, il faudra accepter de se laisser toucher.
Objectifs de formation
- appréhender les problématiques de l’interaction entre création artistiques et innovations techniques, dans une perspective réflexive et critique ;
- acquérir ou renforcer une familiarité avec les discours théoriques tenus sur les questions esthétiques, écologiques sociales et politiques en matière de créativité artistique et technologique ;
- assimiler des connaissances méthodologiques dans le domaine de la recherche-création, recherche-action et recherche-développement ;
- ouvrir l’esprit des diplômés de Master issus de filières scientifiques sur les problématiques de l’art et de la conceptualisation des idées (adaptation numérique pour l’immersion 3D, création de prototypes d’une idée artistique conceptuelle, etc.).
Cette formation, basée sur des ateliers davantage que sur l’enseignement magistral, permettra aux étudiant·es de développer les savoir-faire suivant :
- approfondir une problématique de recherche ;
- situer l’objet de recherche dans le champ actuel des investigations au carrefour des pratiques artistiques, des innovations techniques et de leurs implications sociales ;
- affirmer sa singularité de chercheur au sein d’un travail collectif ;
- formuler un projet de recherche de façon rigoureuse, succincte et convaincante ;
- repérer les institutions et les dispositifs susceptibles de contribuer au financement d’un projet de recherche.
Publics visés :
- étudiant·es venant de formations artistiques pour leur permettre de mieux maîtriser les attentes, les codes et les habitudes de la recherche universitaire ;
- diplômé·es d’un master universitaire pour s’inspirer de certaines pratiques de création artistique et dynamiser leurs enquêtes et leurs réflexions ;
- professionnel·les en formation continue désirant aiguiser leurs capacités de recherche au croisement des arts, des sciences et des humanités.
Seront appréciés des objets de recherche traitant des questions relatives aux mutations numériques des médialités humaines ainsi qu’aux formes de créations et d’inventions sociales qu’elles appellent.
Ce Diplôme Interuniversitaire est proposé par l’Université Paris 8 Saint-Denis Vincennes et l’Université Paris Nanterre, en étroite collaboration avec les Services d’Orientation Professionnelle.
Enseignements
6 Grandes Conférences publiques avec des personnalités internationalement reconnues.
Cycles de conférences (12h).
Petit séminaire, à la suite des Grandes Conférences, pour permettre aux étudiant·es du D.I.U de discuter de leur projet de recherche avec ces invité·es (12h).
Séminaire Transdisciplinaire avec des enseignant·es de Paris 8 et de Paris Nanterre pour présenter des outils de recherche (concepts, méthodes, terrains, pratiques, programmes, sites, etc.). Ce séminaire prendra la forme d’une discussion-enquête sur les définitions des pratiques de recherche-création et de recherche-action (24h).
Atelier de Travail dirigé pendant toute l’année par Alexandra Saemmer, Mathilde Roussel et Matthieu Raffard pour donner aux étudiant·es l’occasion d’approfondir et de raffiner progressivement leur projet de recherche, qu’ils développeront en collaboration avec les autres participant·es. Quelques ateliers seront consacrés à l’exploration des possibilités concrètes d’obtention d’allocations doctorales à l’échelle européenne, de bourse CIFRE, etc. Une ou deux journée(s) de colloque final permettront aux participant·es de présenter leur projet sous forme d’une intervention de 20 minutes suivie de questions (48h).
Un séminaire et des ateliers sur la recherche-création et les arts du code (modèles, outils, critiques) pour développer une réflexivité permettant d’appréhender, sur une base pratique comme théorique, les enjeux d’un projet qui allie recherche universitaire et création artistique, en particulier (mais pas exclusivement) au sein d’univers numériques (48h).
Un projet de recherche approfondi et élaboré sur l’ensemble de l’année, comprenant un stage de deux mois en entreprise ou laboratoire de recherche ou la rédaction d’un article programmatique.
Guide de l’étudiant·es 2024-2025 en format flipbook
Le guide de l’étudiant·e regroupe les informations pratiques générales sur la formation.