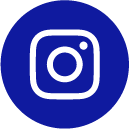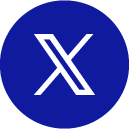Chaque scène étudiée, parfois autour de la figure d’une ou d’un protagoniste, sera ainsi l’occasion d’interroger la manière dont l’activité artistique est soucieuse de se réfléchir dans une perspective anarchiste.
Retrouvez toutes les informations sur le séminaire sur la page de la bibliothèque Kandinsky
Programme 2024
Jeudi 20 juin 2024, 18h30
Judson Dance Group et Grand Union : Entre déhiérarchisation et consensus : un anarchisme improvisé ? – Julie Pellegrin
Séances précédentes
Jeudi 23 novembre 2023, 18h30
Esthétique de la révolte, action directe et pratiques artistiques guérilléristes au Japon
Alexandre Taalba
Jeudi 25 janvier 2024, 18h30, bibliothèque Kandinsky
Chaosmos : l’anarchisme analogique d’Asger Jorn
Maria Stavrinaki

Asger Jorn, Chaosmos, 1961, huile sur toile, 92 x 73 cm © Secher Fine Art & Design, Copenhague
L’univers idéologique d’Asger Jorn est composé d’un nombre de concepts-nomades à fort potentiel métaphorologique. L’anarchie en fait partie : sa fonction est formelle, politique, historique et épistémologique. Changeant souvent tant de statut que de valeur, l’anarchie devient tantôt un régime social propre à un âge, tantôt une ontologie propre à un peuple et tantôt une composante d’un régime idéal total propre à tous. Dans cette intervention, j’essaierai d’esquisser le système mouvant de Jorn sur fond d’un âge où « l’universalisme » politique, esthétique et épistémologique devient l’objet de bien de batailles.
Biographie
Maria Stavrinaki est Professeure associée à l’Université de Lausanne (Faculté des Lettres, Histoire de l’art contemporain). Elle s’intéresse aux croisements de l’art moderne et contemporain avec les sciences humaines et sociales et la pensée politique, en abordant surtout des questions relatives au temps et à l’histoire. Dans quelle mesure et de quelles façons les récits normatifs sur la modernité peuvent-ils être pensés à nouveaux frais ? Sa recherche la plus récente a donné Saisis par la préhistoire. Enquête sur l’art et le temps des modernes (Dijon, 2019, traduction en anglais chez Zone Books en 2022) et la codirection de l’exposition Préhistoire. Une énigme moderne (Centre Pompidou, 2019). Actuellement, elle travaille sur l’art, l’historicité et les épistémologies des années 1950-1970 et codirige, avec Julia Garimorth, une exposition sur l’art à l’âge atomique au Musée d’art moderne de Paris (2024).
Jeudi 28 mars 2023, 18h30
I wanna be Anarchy. And I wanna be Anarchy. Oh what a name!
Tancrède Ramonet

Sid Vicious, Johnny Rotten and Steve Jones des Sex Pistols, 1977 © Photographie : Elisa Leonelli/Shutterstock
1977 : coup de tonnerre dans le ciel encore psyché de l’industrie musicale. Des jeunes aux cheveux peroxydés viennent de se saisir de guitares et poussent leurs chansons comme d’autres avant eux posaient des bombes. Qui sont-ils, eux, qui chantent l’anarchie et exigent la destruction de tous les pouvoirs ? Ils s’appellent les Sex Pistols. Leur jeunesse arrogante et leur beauté magnétique fascinent bien sûr aussitôt les caméras. Mais, dès le début, on s’interroge sur l’authenticité de leur engagement et sur la réalité de leurs motivations révolutionnaires. L’anarchisme de ces rockers qui ne lisent pas Bakounine et semblent plus s’intéresser à la volupté de la destruction qu’à la passion créatrice ne serait-il pas que de façade ? Eux qui critiquent la société du spectacle, n’en seraient-ils pas plutôt les purs produits ? Marketing, escroquerie ou révolution, qu’est-ce que le punk ? Alors que, même dans le mouvement anarchiste organisé, on se défie de cette mode qui fait à nouveau rimer l’anarchisme avec le désordre et le chaos, certains révolutionnaires n’en voient pas moins dans la révolte sincère et totale des punks la possibilité d’un renouvellement du mouvement libertaire.
Biographie
Tancrède Ramonet est auteur de documentaires et producteur audiovisuel. Diplômé en Philosophie (Sorbonne), Management (Paris-Dauphine), Création documentaire (La Havane) et Production internationale (EURODOC), il a fondé la société indépendante de production audiovisuelle de documentaires et de fictions Temps noir en 2002. Il produit des films autour de problématiques sociales, historiques, artistiques et culturelles. Parmi ses productions les plus récentes, on compte Gérard Philipe, le dernier hiver du Cid, d’après le roman de Jérôme Garcin (Présentation spéciale à Cannes Classic, 2022), Les Fantômes de la colonisation (France télévisions), Cuba, la Révolution et le monde (Coproduction Arte/BBC), La Diplomatie du vaccin (Arte), Le Rêve pavillonnaire, les dessous d’un modèle (France 5) et un premier long-métrage : Le Tigre et le Président (Dibona Films, Temps noir, Pan-Européenne, 2022). Également réalisateur, en 2022, il achève les deux derniers volets de la quadrilogie Ni Dieu Ni Maître, une histoire de l’anarchisme. Il signe aussi plusieurs podcasts avec sa complice Ovidie, parmi lesquels Vivre sans sexualité, la Dialectique du calbute sale ou Qu’est-ce qui pourrait sauver l’amour. Tancrède Ramonet a obtenu nationalement et internationalement de nombreux prix parmi lesquels : Prix du meilleur scénariste au Rendez-vous de l’histoire de Blois, Prix du meilleur jeune producteur français et Prix du meilleur producteur français décerné par la Procirep, Prix du meilleur réalisateur au History film festival.
Jeudi 23 mai 2024, 18h30
Au voleur ! Anarchisme et philosophie – Catherine Malabou