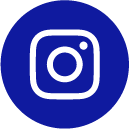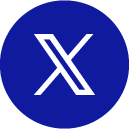Décollectionner, refigurer : pour une approche critique de la (ré)appropriation en contexte postcolonial, Assia Piqueras
Il y a près de quinze ans, on m’a légué un collier, sans rituel ni témoin, presque furtivement — un assemblage d’ossements et de pierres, avec pour seuls repères une origine (Pérou) et une destination (à conserver). Je l’ai rangé dans un tiroir, et je l’ai oublié. Il tient aujourd’hui dans ma main comme l’indice silencieux d’une histoire coloniale qui m’interpelle à plus d’un titre, en tant que descendante, artiste et chercheuse. Autour de cet objet-monde gravitent des récits fragmentaires, contradictoires, réticents, qui m’orientent vers un même territoire : la vallée du Chancay, au nord de Lima, dont certains de mes aïeux exhumaient les vestiges par goût de la collection, et où, un siècle plus tôt, des milliers de coolies chinois avaient été introduits pour remplacer la main-d’œuvre esclave dans les champs de canne à sucre du pays. La matérialité du collier désigne ainsi des lignes névralgiques, de parures en trophées. Elle pèse de toute une mémoire ignorée ou refoulée dont elle est la trace, avec ses spectres de spoliation.
Inscrit dans une perspective transdisciplinaire en anthropologie et en arts, le projet tend à extraire le collier de son assimilation forcée à mon patrimoine familial et de son confinement mémoriel, pour renouveler l’analyse des logiques d’appropriation matérielle et représentative en contexte postcolonial. L’approche associe l’enquête ethnographique à la création documentaire, autour d’une articulation forte entre percepts et concepts. Elle mobilise la méthode biographique visant les artefacts matériels pour restituer la complexité des phases contextuelles traversées par l’objet, procéder à l’analyse ostéologique et gemmologique de ses éléments, et réfléchir sur la dimension herméneutique de la (ré)appropriation artistique. La fabrication d’une réplique du collier en plastique de canne à sucre constituera un premier essai critique pour réinvestir le lien entre deux corpus d’ossements et leur territoire, en réactualisant la matière première des plantations sucrières dans les modalités controversées du matériau biosourcé. Adossée à une enquête multi-située, menée par la parole et par l’image, cette recherche fait du collier — et de sa copie — le fil conducteur de la relation ethnographique et filmique. Porté, refusé, discuté ou occulté par les personnes avec qui je travaille, il suscite des effets de remémoration et d’interprétation, révélant la manière dont les fragments d’une transmission en partie secrète et familiale peuvent rendre compte de la férocité des mondes produits par la violence coloniale, et participer d’une autre manière de faire mémoire.
Biographie
Ancienne élève de l’École normale supérieure et du Fresnoy — Studio national des arts contemporains, Assia Piqueras est titulaire d’un master en cinéma documentaire et anthropologie visuelle de l’université Paris Nanterre. Elle prépare actuellement une thèse d’anthropologie en recherche-création, sous la direction d’Aline Hémond, au sein du LESC (Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative). Ses films et ses installations doivent beaucoup à l’écriture et à la pratique du terrain, dans leur parcours à travers la mémoire traumatique et la violence héritée. Son travail a été présenté en France et à l’étranger, dans de nombreux festivals, programmations en ligne, séminaires et lieux d’art contemporain, tels que la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, Ji.hlava IDFF, Clermont-Ferrand ISFF, Corsica.Doc, Filmer le Travail, Chute Film Coop: Experimental Cinema, le Círculo de Bellas Artes (Madrid), la galerie CRUCE — Arte y Pensamiento Contemporáneo (Madrid), Le Bleu du Ciel — Centre de photographie contemporaine (Lyon), ou l’Institut de France (Paris). En 2022–2023, elle a été pensionnaire de la Casa de Velázquez, et a reçu le soutien de la Fondation des Artistes pour son projet de résidence à l’origine de sa thèse de doctorat.
ÉQUIPE DU PROJET
Directrice de thèse : Aline Hémond
École doctorale : Espaces, Temps, Cultures (ETC) – ED 395 – Université Paris Nanterre