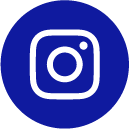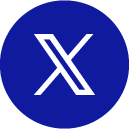Les définitions habituelles de l’intermédialité et de l’interactivité présupposent de confortables séparations : il y a des sujets humains (artistes ou spectateurs) qui font porter leur attention sur des objets esthétiques (images, textes, sons) – les questions étant de savoir si ces objets passent d’un medium à l’autre (inter-médialité) et si les sujets spectateurs sont reconnus comme jouant une part active dans la production desdits objets (inter-activité). Dans tous les cas, on est dans un entre-deux qui postule et respecte une certaine extériorité séparant la sphère des objets de celle des sujets. Au pire, on ne sait plus nommer de quel medium différencié il s’agit, ou on ne sait plus distinguer entre les producteurs et les récepteurs de l’œuvre. Même si l’on parle d’entre-deux (inter-), l’œuvre reste sagement d’un côté, et nous de l’autre.
J’aimerais réfléchir ici à une autre forme d’intermédialité et d’interaction – où ce sont nous, les sujets humains, qui sommes dans l’espace inter-médiaire. Nous n’y sommes plus en face d’images à produire ou à contempler, nous ne sommes plus devant des media qui entremêlent leurs différences génériques : nous sommes dedans, immergés dans les circulations médiatiques – in medias res mediaticas – dans un état à la fois parfaitement banal et parfaitement traumatique d’im-médialité. Nous sommes bien « entre » les media, mais au sens où l’on se trouve marcher « parmi » une foule en mouvement : au milieu d’elle et largement fondu en elle et par elle. Alors que l’inter-activité préserve l’individualité des sujets dont elle occasionne le renversement des rôles, on est ici partie prenante de phénomènes que Karen Barad a qualifiés d’intra-actions : c’est tout un agencement dont nous faisons partie qui agit sur lui-même à travers nous ; nous sommes l’un des inter-médiaires de cette intra-action. Le renversement des rôles est alors bien plus inquiétant : nous devenons images, tandis que les images deviennent sujets. On parle souvent dans ces cas d’« illusion » – terme qu’il faut entendre dans le sens fort (et ubiquitaire dans le monde social) que lui a donné Pierre Bourdieu : l’illusio est le jeu (-ludus) dans (in-) lequel je suis pris bien au-delà de mon contrôle, tout en sachant que je suis en train de jouer. Dans quelle mesure un médiartivisme reste envisageable au sein de cette immersion illusoire dans l’immédialité, et dans quelle mesure une autre définition de l’intermédialité esthétique peut y jouer un rôle – c’est ce qu’essaiera d’éclaircir cet article.
Le « délire technique » : Neo/Malvo, mon semblable, mon frère ?
Dans un article consacré à l’imaginaire de la mégamachine à influence mentale symbolisée par le scénario baudrillardesque du film The Matrix ‒ dernier avatar en date du malin génie cartésien et de la caverne platonicienne ‒ Jeffrey Sconce se penche sur un type particulier d’affection mentale identifié par certains psychiatres sous le nom de « délire technique » [technical delusion] :
En traduisant la « simulation » en termes bruts de mirage technologique, The Matrix a simplement dramatisé la suspicion rampante de voir les media électroniques être capables de contrôler notre réalité et nos esprits par la transmission d’« influences invisibles », grâce à une puissance produite au point de convergence sémantique et institutionnelle entre des formes de pouvoir consistant en transmission électromagnétique et en contrôle sociopolitique. Les psychiatres ont appelé cette affection mentale le « délire technique ». […] Comme les canaris dans les mines de charbon, ces cas de schizophrénie « d’influence » ont peut-être été les premiers à comprendre les implications de notre immersion dans un monde où les technologies médiatiques ‒ composées d’appareils destinés à convertir différents modes de pouvoir en énergie et d’énergie en pouvoir ‒ pourraient mettre en œuvre les agendas secrets de forces sociopolitiques plus sinistres.
On connaît la rengaine qui prend généralement la forme de questions : est-ce folie que de se croire réellement plongé dans une Matrix, lorsqu’on prend la mesure de l’influence des images, des sons, des récits, des petites phrases, des argumentaires, des buzz et des spins qui nous traversent et nous tournent dans la tête à longueur de journée, du fait de notre immersion dans un monde d’affiches publicitaires, de quotidiens gratuits, de podcasts, de téléjournal, de séries télévisées, de pop-ups et de cookies ? Serait-il délirant de la part du montagnard afghan ou au combattant syrien que de croire se déplacer au sein d’un énorme jeu vidéo aux dimensions planétaires, dont il n’est qu’un pion observé, surveillé, secouru ou annihilé, selon un agenda décidé très loin de lui, dans les bureaux climatisés d’une Agence Centrale d’Intelligence hyper-technologisée ? L’illusion consiste-t-elle à se croire vivre dans une Matrix, ou n’est-elle pas, au contraire, de ne pas voir à quel point nous y sommes tous désormais réellement immergés ? Le « délire technique », que Jeffrey Sconce va repêcher dans les revues spécialisées de psychiatrie et dans les archives du passé, n’est-il pas la condition socio-mentale de notre temps ‒ une condition caractérisée par une ontologie de l’immédialité ?
Après avoir passé en revue différents journaux de psychotiques (dont le cas fameux du Président Schreber) modulant les deux modes principaux de délire technique ‒ celui censé opérer par « insertion de pensées », lorsque le sujet sent que sa conscience intime est colonisée par des discours extérieurs, et celui censé opérer par « diffusion de pensées », lorsqu’il croit que ses sentiments privés sont publiés malgré lui à la connaissance de tous ‒ Jeffrey Sconce dédie la fin de son article au cas particulièrement symptomatique de Lee Boyd Malvo, l’adolescent d’origine jamaïcaine responsable, avec son partenaire plus âgé John Allen Muhammad, des attaques de sniper qui ont tué dix personnes et terrifié toute la région de Washington DC en octobre 2002. Après son arrestation, le jeune homme conseilla aux psychiatres de regarder The Matrix pour comprendre ses motivations, film qu’il prétend avoir visionné plus d’une centaine de fois et dont le protagoniste Neo, en lutte à mort contre la mégamachine à formater les esprits, lui a servi d’inspiration. La finalité des meurtres qu’il exécutait depuis sa Chevrolet autour du périphérique de Washington était de créer une panique collective grâce à l’intense couverture médiatique que recevraient ses agissements, « de façon à provoquer le déclenchement de la loi martiale, ce qui à son tour devrait "inciter une révolution raciale contre l’oppression continue du peuple noir", avec pour effet ultime de fonder une colonie idyllique au Canada ». Comme le précise Jeffrey Sconce,
l’identification de Malvo au film [The Matrix] était tout à fait dans la ligne du contenu thématique central de ce dernier : l’administration technocratique du pouvoir politique à travers la simulation médiatique, « message » que Malvo a très bien compris et intégré dans son effort pour expliquer et pour réagir stratégiquement à la thèse ‒ pas si déraisonnable que cela ‒ voulant que la culture « blanche » ait en effet utilisé le capital et la technologie pour soumettre, exploiter et peut-être même exterminer la population « non-blanche » de la planète. […] Un tel scénario est certes « délirant » [insane], mais il y aurait sans doute bien des désaccords s’il l’on devait de localiser précisément à quel point exact ce plan d’action bascule dans la « psychose », c’est-à-dire à quel point il rompt avec une logique sociale partagée et considérée comme « saine » [sane]. Après tout, cette action a bel et bien réussi à créer un cycle de terreur diffusé 24 heures sur 24 par les chaînes télévisées pendant environ deux semaines.
Ici encore, la même rengaine de questions se pose, dès lors qu’on resitue ces faits au sein de l’enchantement permanent des technologies médiatiques qui trament notre quotidien : Lee Boyd Malvo et John Allen Muhammad nous plongent-ils au cœur d’une illusion criminelle et psychotique, ou fraient-ils la voie de modes de résistance dramatiquement lucides et réalistes, contre un écosystème médiatique qui est lui-même à la racine des psychoses et des crimes qui se retournent contre lui ? Comme le souligne encore Jeffrey Sconce, contrairement au Président Schreber et à ses acolytes victimes du « délire technique », Lee Boyd Malvo n’est plus en position de victime d’insertions mentales ou de diffusions d’intimité subies contre son gré. Au lieu d’être la cible de machines d’influences qui le tourmentent, il « suggère un avenir où un nombre croissant de psychotiques se considéreront comme les sources intentionnelles de contenus et de transmissions par les médias, en position de donner activement forme à l’environnement médiatique » : « grâce à une stratégie médiatique destinée à combattre les médias tout en dérivant sa force des médias eux-mêmes », il incarne une illusion particulièrement troublante, mais aussi remarquablement lucide : celle d’« être les médias ».
En écho à Jeffrey Sconce qui terminait son article de 2011 sur l’illusion délirante « I am the media », James Holmes, 24 ans, doctorant de l’université de Colorado, diplômé en neurosciences, tuait 12 personnes et en blessait 58, le 20 juillet 2012 à Aurora, Colorado, en mitraillant les spectateurs d’un cinéma venu voir le dernier Batman, The Dark Knight Rises : il s’était déguisé en faisant croire à une attraction publicitaire pour le film, et paraît avoir dit au moment de tirer « I am the Joker ». Un ouvrage récent de Franco Berardi montre, entre autres choses, à quel point un tel comportement – loin d’être « aberrant » – se trouve pleinement en phase avec les logiques à la fois compétitives et spectaculaires qui gouvernent l’économie sémiocapitaliste de l’attention en notre début du XXIe siècle.
J’ai laissé de côté jusqu’à présent l’élément qui est sans doute le plus déstabilisant dans l’histoire de Lee Boyd Malvo, telle que la raconte Jeffrey Sconce : loin de s’identifier au personnage de Neo de façon schizophrénique, comme on le dit souvent d’autres auteurs de massacres indiscriminés prétendument incapables de faire le départ entre « la vérité » et « l’illusion », le jeune homme n’a vu dans le film qu’une fiction allégorique produite à Hollywood. Comme chacun de nous, il a été « influencé » par elle : il a été ravi par ses effets spéciaux, il s’est passionné pour les aventures de ses protagonistes, il en a tiré des interprétations politiques qui l’ont aidé à donner sens à son existence. Mais jamais il ne « s’est cru » vivre « réellement » dans la Matrix : jamais il ne paraît avoir fait d’erreur de jugement sur ce que nous considérons comme les frontières entre un monde fictionnel présenté sur un écran et le monde actuel dans lequel prennent place nos actions responsables. Il savait que les images n’étaient que des images, que l’illusio était un jeu : mais il savait aussi que ce jeu n’était pas une simple plaisanterie insignifiante, et que les images qui circulent entre nos media affectent réellement ceux qu’elles traversent.
Il a donc bien cru à quelque chose. Si le film a pu l’éclairer sur sa condition et l’aider à s’orienter dans notre monde si déroutant, c’est qu’il « s’est reconnu » dans la Matrix ‒ comme chacun de nous peut se reconnaître dans les univers mis en scène par Michelangelo Antonioni, Andrei Tarkovski ou Lars von Trier. Lee Boyd Malvo emblématise ainsi admirablement l’immédialité : il a vu un film, dont les images l’ont aidé à donner sens à son environnement, ce qui lui a permis d’« imaginer » des actions lui donnant une certaine prise sur cet environnement (partiellement composé) d’images. Sa subjectivité, son agentivité (agency) peuvent être considérées – sans mépris pour lui, ni sans esprit conspirationniste – comme induites par l’intra-action de la circulation des images entre les écrans et les systèmes nerveux humains. Il vit, comme nous tous, dans les media, au milieu des « milieux » qu’ils constituent – et qu’annonce leur étymologie (in medias res). On pourrait même caractériser son geste comme un parangon d’intermédialité interactive : il a fait passer le contenu d’un film (The Matrix) de l’écran de cinéma aux petit écrans des télévisions regardées par les téléspectateurs apeurés de la région de Washington (inter-médialité) ; il ne s’est pas contenté de regarder passivement une œuvre d’art, il lui a répondu activement en cherchant à infiltrer la circulation des images médiatiques pour déclencher une révolution anti-raciste, contribuant au sequel « dans le réel » de la machine à simuler le réel (inter-activité).
L’immédialité à l’âge du métaréalisme
Dans The Object of Art, Marian Hobson a montré que le xviiie siècle a connu une transformation de la notion d’illusion, témoignant d’une nouvelle attente face à l’œuvre d’art. Au début du siècle, dans l’esthétique rococo, on se situait dans une illusion bi-modale, au sein de laquelle une représentation pouvait être à la fois vraie et irréelle. L’attention y relevait du « papillotage » : on regardait un multiple éclaté, on passait d’un objet à l’autre sans chercher forcément une cohérence profonde dans l’univers représenté. Surtout, on ne se souciait guère des décalages et des incohérences entre l’intérieur du monde représenté (la perspective en 3D propre à la situation fictive des personnages) et l’extérieur du monde actuel (le cadre du tableau, les limites de la scène, notre attitude de spectateur) ‒ le passage de l’un à l’autre semblant aisé, naturel, non problématique puisque nous savons être à la fois plongés dans une fiction illusoire et lucides sur son statut de fiction.
À partir d’environ 1750, l’époque serait entrée dans un rapport bi-polaire à l’illusion : une représentation est soit vraie, soit fausse, on ne cherche plus à jouer le jeu d’une apparence trompeuse, mais à produire une réplique qui soit adéquate à la réalité représentée ; on cesse de papilloter librement entre les multiples éléments d’un décor et de son cadre, on met l’accent sur la cohérence interne à l’objet d’art et sur son rapport de représentant envers la réalité représentée. Bref, on est soit dedans (illusion), soit dehors (lucidité). Cette évolution s’illustre dans le type de peinture qu’il convient d’exécuter sur un plafond : avant le milieu du siècle, tout peut y figurer pourvu que cela soit charmant et bien réalisé (la convention qu’il s’agit d’un décor artificiel étant admise par tous) ; à partir de 1750, on ne peut plus représenter au plafond que ce qui serait vu vers le haut depuis un regard humain (un ciel, des anges, un toit, etc.).
Dans The Language of New Media, Lev Manovich souligne que « les théories existantes de l’illusionnisme présupposent que le sujet agit strictement en spectateur », alors que « les nouveaux media ont plutôt tendance à le transformer en utilisateur ». Contrairement au spectateur de théâtre ou de cinéma, immobilisé et isolé dans son siège de façon à mieux s’absorber dans l’œuvre qui lui est présentée, le joueur et l’internaute doivent sans cesse intervenir physiquement dans le déroulement de ce que leur propose l’écran : à travers des clics, des menus déroulants, des joysticks, ils utilisent des images qui ont fonction d’instruments (comme les icônes), et non plus seulement de représentation :
À la différence du réalisme totalisant [du théâtre et du cinéma traditionnels], l’esthétique des nouveaux media s’apparente de manière étonnante à celle de l’avant-garde de gauche au xxe siècle. La stratégie employée par le dramaturge Bertold Brecht consistant à divulguer les conditions de production d’une illusion, reprise par d’innombrables artistes de gauche, a été intégrée aux logiciels et aux matériels informatiques eux-mêmes. De même, le concept de Benjamin d’une « réception dans la distraction » trouve à se réaliser pleinement. […] Le sujet ne peut qu’osciller entre les rôles de spectateur et d’utilisateur, entre la perception et l’action, entre l’intérêt pour l’histoire et une participation active. Un segment le met en présence d’un récit cinématographique captivant. Soudain, l’image se fige, des menus et des icônes apparaissent, et le sujet est obligé d’agir : faire des choix, cliquer, appuyer sur des boutons.
Lev Manovich nomme métaréalisme cette attitude d’oscillation constante entre immersion et émersion, perception et action, croyance et incrédulité. Il retrouve par là même le régime d’illusion que Marian Hobson qualifiait de « bi-modal », qui ne se serait donc estompé après 1750 que pour revenir en force à notre époque. Loin de se restreindre aux seuls dispositifs techniques qui assurent notre accès au monde des jeux vidéo et des enchantements de l’internet, le métaréalisme est pour Lev Manovich un phénomène bien plus large, participant d’une mutation culturelle que les années 1980 ont identifiée au « postmoderne ». C’est tout notre rapport à « l’idéologie » ‒ aux programmes politiques, au matraquage publicitaire, aux systèmes philosophiques, aux mouvements esthétiques ‒ qui relève du métaréalisme : face à tous ces discours qui en appellent à notre adhésion, nous oscillons sans cesse entre prise et déprise, croyance et incrédulité, enthousiasme et autocritique, engagement et ironie. Cette posture bi-modale trouve son modèle dans l’attitude que nous cultivons envers l’illusion fictionnelle, qui nous voit le plus souvent avoir un pied dans l’immersion (expliquant que nos pulsations cardiaques s’accélèrent lorsque le protagoniste traverse une passe angoissante) et la réflexion critique (gardant toujours à l’esprit que nous sommes en train de lire un livre ou de voir un film). Alfonso Iacono a très bien développé certains mécanismes de ce métaréalisme en reprenant de Alfred Schutz la notion de « mondes intermédiaires », et en montrant que nous vivons toujours au sein d’un pluralisme de mondes (mémoriels et fictionnels) à la fois superposés, décalés et hétérogènes entre eux, qui nous permettent d’évaluer les mérites de l’un relativement aux insuffisances des autres.
L’immédialité entre immédiacie et hypermédiacie
L’oscillation que Lev Manovich met au cœur du métaréalisme prend une forme encore plus suggestive lorsqu’on l’éclaire à la lumière des deux logiques apparemment contradictoires, mais en réalité complémentaires, que Jay David Bolter et Richard Grusin ont analysées dans leur ouvrage Remediation ‒ où ils démontrent, à la suite de Marshall McLuhan, que les nouveaux media reprennent toujours des media préexistants, qu’ils reconfigurent et redynamisent par ce geste de re-médiation. Les deux logiques qu’ils identifient vont nous aider à comprendre deux dimensions perpendiculaires de l’immédialité à l’époque des PC, des smartphones et du World Wide Web – qui constituent aussi deux façons non seulement d’être dans/parmi/entre les media, mais plus simplement d’« être les media » (I am the Joker).
La première logique est celle de l’immédiacie (immediacy), qui vise à rendre le medium aussi transparent et invisible que possible. Lorsque, devant un tableau de l’âge classique, je vois le personnage, la situation ou le paysage dépeints, plutôt que la touche de l’artiste sur la surface de la toile, lorsqu’une photographie ou un enregistrement me font voir le visage de ma grand-mère ou me font entendre un cours de Gilles Deleuze vingt ans après leur disparition, le mouvement d’immersion qui me fait plonger dans la réalité (absente, mais représentée), comme si j’étais en sa présence actuelle, illustre cette logique de l’immédiacie. Celle-ci repose, de façon plus générale, sur « la croyance en un certain point de contact nécessaire entre le medium et ce qu’il représente ». Ce point de contact nécessaire censé assurer la transparence de la représentation peut consister dans le respect des lois de la perspective, que l’on considère (ou perçoit) comme « naturelles » et comme fournissant une sorte de degré zéro de la déformation ; mais il peut aussi reposer sur l’automatisme neutre de l’appareil d’enregistrement, comme c’est le cas avec « l’ontologie de l’image photographique » théorisée par André Bazin, et reprise par Roland Barthes lorsqu’il assimile l’émotion propre à la photographie au sentiment que « ça a été ». Dans tous les cas d’immédiacie, l’illusion opère par l’effacement du medium qui paraît laisser voir de façon transparente la réalité absente représentée.
La seconde logique est celle de l’hypermédiacie (hypermediacy), dans laquelle, au contraire, le medium lui-même (avec sa surface, ses cadres, son appareillage, ses fonctions, ses affichages) se trouve mis au premier plan. Au lieu de se rendre transparent et comme absent pour laisser paraître une présence lointaine qui se manifeste à travers lui, le medium exhibe sa présence propre, son opacité, ses déformations et ses interférences. L’hypermédiacie se manifeste aujourd’hui de la façon la plus symptomatique à travers la multiplicité des fenêtres ouvertes simultanément sur nos écrans d’ordinateurs : alors que la haute définition de mon écran me permettrait en principe de m’y plonger dans une image en plein-écran merveilleusement réaliste et illusionniste, qui pourrait (en principe) me faire croire que je vois la réalité elle-même, dans toute sa richesse et sa densité, comme à travers une fenêtre, ce que j’ai actuellement sous les yeux se compose d’une multitude de fenêtres superposées en décalage les unes par rapport aux autres ‒ avec ce texte de cet article que je suis en train de rédiger, avec un navigateur Firefox ouvert sur une page Wikipedia (où je viens de vérifier une référence bibliographique), avec différentes icônes me permettant de déclencher rapidement divers programmes depuis mon bureau, et avec pour fond d’écran, qui apparaît autour des multiples fenêtres ainsi ouvertes, une reproduction du tableau Carolina Shout de Romare Bearden :
Si la logique de l’immédiacie nous conduit soit à effacer, soit à rendre automatique l’acte de représentation, la logique de l’hypermédiacie reconnaît de multiples actes de représentation et les rend visibles. Là où l’immédiacie suggère un espace visuel unifié, l’hypermédiacie contemporaine offre un espace hétérogène, dans lequel la représentation est conçue non pas comme un cadre de fenêtre ouvert sur le monde, mais plutôt comme le cadrage lui-même ‒ avec des fenêtres qui ouvrent sur d’autres représentations et sur d’autres media. La logique de l’hypermédiacie multiplie les signes de médiations et tente de cette façon de reproduire le riche sensorium de l’expérience humaine. […] De même que le World Wide Web illustre au mieux la logique de l’hypermédiacie, la réalité virtuelle est l’exemple le plus clair (le plus transparent !) de la logique de l’immédiacie transparente.
L’immédialité qui nous fait « être les media » se présente donc de deux façons très différentes. Soit on est conduit à se confondre avec ce que les media prétendent rendre présent, en jouant la carte de l’immédiacie. C’est en quelque sorte ce que faisait Lee Boyd Malvo, le sniper du Beltway de Washington, en incarnant dans la réalité tragiquement immédiate le tueur en série dont tant de films et tant de feuilletons télévisés font miroiter la menace angoissante sur nos divers écrans. Mais on peut aussi « être les media » en faisant sentir la présence encombrante et invasive de tous ces écrans eux-mêmes, en jouant la carte de l’hypermédiacie. C’est ce que faisait aussi Lee Boyd Malvo en parvenant, pendant une dizaine de jours, à occuper par son invisibilité menaçante les écrans télévisés de toute une nation, écrans vides puisqu’incapables de le saisir, apparaissant donc dans la vérité de leur travail de cadrage, plus que dans le contenu qu’ils sont censés véhiculer.
La couverture télévisuelle de l’événement oscillait sans cesse entre ces deux dimensions : d’une part (versant hypermédiacie), une multitude de fenêtres ouvertes simultanément (chefs de la police, familles de victimes, témoins, responsables politiques, experts en psychiatrie ou en traque de tueurs fous), se renvoyant les unes aux autres pour essayer désespérément de cerner une réalité restant dramatiquement absente ; d’autre part (versant immédiacie), quelques fausses alertes et poursuites en voiture filmées d’hélicoptère pour nous plonger dans la réalité du drame en train de se jouer, en direct et sous nos yeux (prolongés par des caméras, des émetteurs-récepteurs d’ondes hertziennes et des câbles électriques). Même lors de tels épisodes de chasse à l’homme, des rubans défilant continuaient toutefois, en bas d’écran, à annoncer la météo prévue pour le week-end, les numéros gagnants de la loterie ou les dernières cotations en bourse (remédiation de l’hypermédiacie au sein de l’immédiacie).
On le voit, immédiacie et hypermédiacie sont deux dimensions perpendiculaires de l’immédialité, qui ne sont donc nullement incompatibles entre elles. Nous avons pris l’habitude (bi-modale, méta-réaliste) d’osciller constamment de l’une à l’autre, selon d’incessants mouvements d’immersion et d’émersion entre les mondes intermédiaires que nous proposent nos existences inter-médiales. Suivant qu’on habite en Californie ou aux environs immédiats de Washington, on envisagera bien entendu la traque du sniper avec plus ou moins de distance métaréaliste. Mais dans tous les cas, on en suivra le développement à travers un mélange instable de détachement, puisque, hormis les victimes directes, cela ne nous touche que par la médiation sans danger des écrans, et d’implication, puisque c’est bien « chez nous », que ça se passe, dans notre ville, notre région, notre pays, « notre réalité » ‒ mais justement, à l’âge de la téléprésence, le sens exact des mots « notre » et « réalité » devient éminemment problématique.
Pendant la dizaine de jours où les images (de l’absence) de Lee Boyd Malvo et John Allen Muhammad ont occupé les écrans nord-américains, environ 600 personnes ont été victimes d’homicides aux USA, avec une probabilité six fois plus grande pour les Africains-Américains que pour les Blancs d’être tués de cette façon. C’est sans doute parce que les victimes du sniper étaient toutes blanches ‒ du fait d’un choix très ciblé ‒ que l’émoi médiatique a été aussi intense. La « réalité » de cette dizaine de jours était bien entendu aussi celle des 590 autres victimes d’homicides, généralement cantonnées dans des quartiers pauvres et noirs ou latino, dont on ne parle que pour compter les statistiques et les taux de chômage. Ici aussi, on pourrait dire que Lee Boyd Malvo était davantage dans la réalité que les chaines de télévisions, en ramenant à des conflits politiques de race ce que celles-ci s’efforçaient de présenter comme un problème de criminalité ou de psychopathie.
L’intra-action immédiale
Tout ce que j’ai pu relever dans l’histoire (sinistre) de cette série de meurtres (évidemment indéfendables) paraît tendre à faire de Lee Boyd Malvo non seulement un exemple d’immédialité (intermédiale et interactive), mais un héros du médiactivisme. Il a agi sur le monde en parvenant à occuper les médias de masse nord-américains pendant une dizaine de jours – non seulement pour la gloriole de son petit narcissisme égocentrique, mais au nom d’une cause respectable, celle de la lutte contre les oppressions et les inégalités raciales encore si prégnantes aux USA. Et de fait, il ne serait pas déraisonnable de faire du médiactivisme une exigence fondamentale des pratiques artistiques contemporaines – pour faire face à l’urgence climatique, au saccage néolibéral des relations sociales, à l’effondrement de la diversité biologique et culturelle, et au rôle que les médias de masse jouent au sein de toutes ces calamités. Pour le dire autrement : les pratiques esthétiques s’exposent aujourd’hui à une accusation légitime d’« esthétisme » dès lors qu’elles ne se préoccupent pas d’intervenir dans la circulation médiatique des images, des discours et des sons. La question me paraît toutefois de faire le départ entre médiactivisme et médiartivisme – et de montrer la désirabilité supérieure du second sur le premier.
Le malaise causé par l’affirmation de Karlheinz Stockhausen interprétant les attentats du 11 septembre 2001 comme une œuvre d’art était à la fois exagéré (voire souvent hypocrite) et fondamentalement justifié. Non seulement l’art ne sacrifie pas des victimes non-consentantes sur son autel, mais surtout quelque chose d’essentiel dans la mobilisation artistique des media fait fondamentalement défaut dans les actes de violence mobilisés par Lee Boyd Malvo, James Holmes, Al Qaïda ou Daesh. Isoler ce qui manque dans l’épisode analysé ci-dessus peut nous aider à mieux comprendre ce qui fait la spécificité, la force et l’importance d’une pensée et d’une utilisation artistiques – esthétique – des media.
Je solliciterai le vocabulaire mis en place par Karen Barad – malgré sa difficulté – pour cerner ce dont il est question. En réécrivant l’histoire du rôle joué par Niels Bohr dans l’avènement de la physique quantique, elle nous invite à considérer la notion d’agency comme décrite au mieux par le terme d’intra-action :
Agency is a matter of intra-acting; it is an enactment, not something that someone or something has. It cannot be designated as an attribute of subjects or objects (as they do not preexist as such). It is not an attribute whatsoever. Agency is “doing” or “being” in its intra-activity. It is the enactment of iterative changes to particular practices – iterative reconfigurings of topological manifolds of space-time-matter relations – through the dynamics of intra-activity. Agency is about changing possibilities of change entailed in reconfiguring material-discursive apparatuses of bodily production, including in the boundary articulations and exclusions that are marked by those practices in the enactment of a causal structure.
L’immédialité décrite dans les pages précédentes cherchait à faire sentir à quel point nous faisons partie intégrante de circulations d’images qui nous constituent en même temps qu’elles nous traversent. Cette inter-médialité radicale signifie que nous vivons entre les images, entre les media, comme des inter-médiaires qui en assurent la circulation. De ce point de vue, il ne peut y avoir d’agency qu’au sein de cette circulation médiatique d’images : on ne saurait strictement parler d’agency que pour désigner l’intra-action que le système de circulation des images émet et reçoit en innervant nos corps et nos sociétés. Ni Lee Boyd Malvo, ni moi qui écris ce texte, ni vous qui le lisez ne pouvons prétendre agir (sentir, comprendre, penser) de façon réellement extérieure aux space-time-matter relations qui, à travers les filtres de l’attention médiatique, constituent simultanément nos subjectivités, nos cultures, nos systèmes socio-économiques et notre environnement anthropocénique.
Une telle vision – fondamentalement auto-référentielle – des sociétés tend à nous faire concevoir les media comme des flux de données, plus ou moins sensorielles ou plus ou moins abstraites, qui innervent nos corps de stimuli et d’informations. Y opposer des « sujets » à des « objets » préexistants est éminemment discutable. Images et humains se reproduisent les uns dans et à travers les autres – avec toutefois des altérations, des changements, des reconfigurations, des réarticulations auxquelles Karen Barad prête une attention toute particulière dans la citation donné ci-dessus.
L’intra-activité consiste en effet en « l’instauration de changements itératifs au sein de pratiques particulières », en des « reconfigurations itératives de pluralités topologiques de relations espace-temps-matière », en la « transformation des possibilités de transformation impliquées dans la reconfiguration d’appareils matériels-discursifs de production de corps ». Le défi de l’agency intra-active est donc bien de concevoir l’émergence de changements au sein de l’auto-référentialité. Pour ce faire, Karen Barad mobilise la catégorie d’appareil (apparatus), qu’elle illustre avec les appareils de mesure employés dans la physique quantique : l’utilisation d’un certain appareillage de mesure conduit à voir les entités quantiques comme des particules, tandis qu’un autre type d’appareillage les fera apparaître comme des ondes. La question qui a troublé les penseurs était bien entendu celle de savoir ce qu’« était véritablement » la matière, onde ou particule ? Karen Barad montre qu’une telle question n’a pas de sens. Ce que révèle la physique quantique, c’est que ce sont les appareils qui « font » la matière à travers les coupes agentielles (agential cuts) qu’ils y opèrent. Un certain appareil opère une coupe « faisant matière » (mattering) sous forme d’ondes, un autre « fait matière » sous forme de particules. Ce que nous appelons « matière » ne peut nous apparaître que sous les opérations de coupes opérées par de tels appareils.
Son analyse devient fascinante lorsqu’elle joue sur le double sens du mot anglais matter, qui désigne à la fois ce que nous reconnaissons comme une substance matérielle de l’univers (the matter) et ce qui fait que quelque chose a du sens ou de l’importance pour nous (it matters to us). Comme le dit son sous-titre, son livre est consacré à « l’enchevêtrement de la matière et de la signification ». On comprend à présent pourquoi sa théorie est particulièrement adéquate pour nous aider à penser l’immédiation : ce qui a du sens et de l’importance pour nous, c’est ce à quoi ces appareils que sont les media donnent sens et importance pour nous. Ce sont eux qui font que quelque chose matters (ou non), individuellement et collectivement. Cela est vrai non seulement de ce que nous ne percevons qu’à distance, mais également de nos expériences sensorielles les plus « immédiates » et les plus intimes : la façon dont un homme perçoit une forme d’arbre ou dont une femme ressent ses douleurs menstruelles reçoivent une large part de leur intensité et de leur signification de ce nos socio-cultures nous auront sensibilisé à percevoir et à ressentir – à travers les dispositifs médiatiques qu’elles auront mises en place à cet effet.
Le monde – pour Karen Barad comme pour une pensée de l’immédialité – est un enchevêtrement d’inséparation. C’est à travers les coupes qu’y opèrent nos appareils que nous instaurons des séparations qui, tout à la fois, identifient la matière de ce que nous isolons alors comme des objets, et investissent de signification les objets ainsi séparés. Mais ni les objets que nous percevons, ni les sujets que nous sommes ne préexistent à ces opérations – constamment réitérées, quoique potentiellement altérables – effectuées par nos appareils, terme qu’il faut entendre aussi bien dans son sens physique (un appareil photo) qu’institutionnel (tel office de tel ministère).
En même temps que le vocabulaire de l’intra-action emprunté à Karen Barad nous aide à comprendre l’immédialité en général, il nous permet d’opérer une coupe qui montre l’insuffisance et l’échec du mode d’agentivité auquel a eu recours Lee Boyd Malvo. Il s’est rendu tristement célèbre, mais son projet de révolution n’a pas avancé d’un pouce. Selon toute apparence, ses crimes télévisés en direct pendant une dizaine de jours n’ont nullement réussi à « instaurer des changements itératifs au sein de pratiques particulières », ils n’ont pas conduit à « transformer les possibilités de transformation impliquées dans la reconfiguration d’appareils matériels-discursifs de production de corps ». Le système mass-médiatique nord-américain a continuer à ronronner aussi confortablement après qu’avant ses assassinats, identifiant avec les mêmes stéréotypes apparemment justifiés les couleurs de peau foncées avec d’inquiétantes irruptions de criminalité individuelle. L’auto-référentialité de l’immédialité n’a en rien été altérée par les gestes du jeune homme.
En cherchant à définir la notion d’interface, qui est au cœur du travail de médiation opéré par les media, Alexander Galloway a récemment rejeté à la fois le modèle de l’écran et celui de la fenêtre, qui tous deux nous permettraient de « voir ce qui n’est pas (là) » – pour leur préférer celui du seuil : avant d’être une surface de projection ou de sensibilité, une interface consiste en la distinction d’un dedans et d’un dehors, entre lesquelles elle instaure du coup une nouvelle séparation en même temps qu’une nouvelle articulation. On sent la proximité que cela entretient avec ce qu’on vient d’entrevoir grâce à Karen Barad. Il est certes parfaitement justifié de dire, à la suite de Marshall McLuhan, que les media sont des « extensions of man » qui nous relient à l’intérieur d’un réseau nerveux désormais planétaire, ou de reconnaître, avec Siegfried Zielinski, qu’ils constituent « des espaces d’action pour des constructions tentant de connecter ce qui est séparé ». Mais il est également suggestif d’en faire avec Karen Barad et Alexander Galloway des opérateurs de séparation.
Les deux approches peuvent être réunies dans la définition qu’en donne Jussi Parikka : « Les media consistent en une action de plier le temps, l’espace et les agentivités ; ils ne sont pas la substance ou la forme à travers lesquelles des actions prennent place, mais un environnement de relations dans lequel le temps, l’espace et les capacités d’action émergent ». Le pli est à la fois ce qui sépare (les deux pans de la surface pliée) et ce qui relie (puisqu’ils restent attachés l’un à l’autre). Il constitue bien un seuil, sur lequel une opération peut moduler des continuités et des discontinuités structurant notre expérience de ce qui matters à nos yeux (au sens de faire matière et d’avoir de l’importance). La nature indécidable de bien des apories évoquées plus haut tient sans doute à ce que la multiplication et l’intensification de nos appareils médiatiques multiplie les seuils et renverse les rapports entre ce qui est dedans et ce qui est dehors ‒ sous l’horizon de ce vertigineux tourniquet topologique faisant que les médias ne soient tout à la fois qu’une partie limitée de notre vie sociale et individuelle, mais que, simultanément, la médiasphère planétaire soit la totalité la plus englobante de notre destin commun.
On comprend mieux du même coup pourquoi l’essence paradoxale du medium est d’être une médiation visant à l’immédiateté. Comme cela a été signalé depuis longtemps, l’essence des media est paradoxale en ce qu’ils visent tous à abolir leur présence d’intermédiaire : ils ne fonctionnent jamais mieux que lorsqu’ils s’effacent en devenant transparents (par immédiacie). Leur force première vient justement de leur capacité à transmettre une action immédiate, tout en bénéficiant des manipulations d’espace et de temps que permettent leurs dispositifs techniques. Les drones constituent en ceci un parfait medium de guerre : leurs capteurs et leurs bombes permettent d’obtenir une perception et d’exercer une action immédiate sur un champ de bataille situé à l’autre bout de la planète. Et ce travail de médiation et ces impressions d’immédiateté résultent de leur nature immédiale – définie par le fait que nous vivons toujours dans les enchevêtrements médiatiques instaurés par les appareils qui donnent matière et signification à notre monde (à commencer bien sûr par le langage).
De ce point de vue, le « délire technique » est la forme de lucidité propre à notre époque intensément médiatisée. Dans un monde baigné d’ondes hertziennes, de fibre optique, de wifi, de bluetooth et de 4G, chacun de nous passe sa journée à entendre des voix, à avoir des visions et à parler tout seul. La radio, les écrans et les téléphones portables rendent normal ce qui, jusqu’à il y a quelques décennies à peine, constituait un signe évident de psychose. Il faudrait au contraire être fou pour ne pas comprendre que notre immersion dans un monde si intensément médiatisé réalise quotidiennement les deux procédés décrits par les victimes de « délire technique » : notre situation ontologiquement immédiale fait qu’il y a « insertion de pensées » chaque fois que nous allumons une télévision, un poste de radio ou que nous lisons un livre, et qu’il y a « diffusion de pensées » chaque fois que nous visitons Facebook ou que nous naviguons sur internet, dès lors que des logiciels de profilage diffusent aussitôt nos goûts et nos lubies à des myriades de publicitaires.
L’intermédialité esthétique
Comme tout discours totalitaire ou totalisant, celui de l’immédialité est non seulement facile et agaçant, mais certainement faux et fourvoyant. Les contre-exemples de Lee Boyd Malvo ou de James Holmes doivent nous aider à repérer ce qui serait un médiartivisme réussi – comme ont su en pratiquer les féministes et les autres défenseurs des minorités sexuelles, raciales ou ethniques au cours du XXe siècle. Au fur et à mesure que notre état d’immédialité gagne en auto-référentialité, il semble devenir de plus en plus indispensable de ne pas se contenter d’« infiltrer » les médias pour avoir accès aux audiences de « masse », mais de placer au cœur du médiartivisme une coupe agentielle qui opère au sein même de la communication médiatique. Face à des interfaces qui ont pour vocation de s’effacer dans la transparence, chaque utilisateur peut soit tenter de court-circuiter la médiation pour jouer le jeu de l’immédiacie, soit faire voir ce que fait le medium dont il se sert. Si l’on entend mesurer les risques que nous font encourir les illusions où baignent nos formes de vie actuelle, il ne faut pas tant chercher à (faire) « voir la réalité » elle-même (ce qui impliquerait une autre forme de croyance illusoire en une quelconque immédiacie), mais il convient bien plutôt, comme invite à le faire Arturo Mazzarella, de faire porter nos regards sur « l’espace des manipulations auxquelles sont soumises les images », espace qui constitue « le lieu où la reconnaissance de la réalité trouve son cadre le plus fiable ».
On voit qu’il ne s’agit ici que d’un déplacement de l’auto-référentialité, depuis les matières-significations du monde, qui ne renvoient qu’à elles-mêmes et à leur reproduction, vers les agencements médiatiques, qui attirent le regard sur eux pour faire voir la médiation à travers laquelle nous croyons voir le monde. Ce stratégies hypermédiatiques ancestrales, depuis La vie est un songe jusqu’aux films de Jean-Luc Godard, ne perdent rien de leur pertinence à l’âge des écrans numériques ubiquitaires et du métaréalisme dominant, au contraire. Leur vertu et leur force tient à leur capacité à faire opacité contre le court-circuitage du réel opéré par les illusions d’immédiacie, plutôt qu’à se complaire dans le narcissisme de la cupidité attentionnelle.
Lee Boyd Malvo et John Allen Muhammad, les snipers du Beltway, James Holmes, le Joker du cinéma d’Aurora ‒ mais également, bien moins tragiquement, tous ceux d’entre nous qui se retrouvent sur un plateau de téléréalité, dans une scène de micro-trottoir, dans une émission de radio, dans les pages d’un journal ou sur la couverture d’un livre ‒ tous risquent de se laisser happer par le court-circuit d’immédiacie qui transforme nos propos et nos agissements en parodies d’eux-mêmes. Lorsqu’un forcené mitraille une foule anonyme, fût-ce pour dénoncer la persistance de la suprématie blanche ou pour déclencher une révolution religieuse, il se contente d’« être les media » : il est exactement ce dont ils ont besoin pour que les audimats remontent, et pour que les actionnaires puissent engranger leur butin. Pour échapper à ce sort, sans pour autant se contenter d’être le spectateur des scénarisations régies par autrui, il convient peut-être d’apprendre à devenir-medium : expérimenter ce que peut un medium, en tester les gestes-limites, en ne se figeant jamais dans l’identité qu’il nous attribue, mais en cherchant à exalter ses potentiels pour le faire devenir (et nous avec lui) autre chose que ce que nous sommes (nous et lui).
Or, ce que peut un médium – et ce que doit un medium, dès lors qu’on en fait un usage artistique – c’est d’abord s’excéder lui-même. Toutes les remarques qui précèdent convergent vers une même conclusion : alors que nous considérons généralement les media comme des dispositifs, des systèmes, des technologies, des conventions, des entreprises, des écrans, des canaux, des flux, des réseaux, ils devraient avant tout nous apparaître comme les résultats d’un travail ‒ le travail de médiation. Comme le scande Alexander Galloway tout au long de son livre, l’interface n’est pas une chose, mais un effet (l’effet d’un travail) : dans les media, il nous faut apprendre à voir la médiation à l’œuvre, la médiation en train de se faire, le travail de médiation.
D’où une relation essentielle de solidarité à comprendre, à valoriser et à renforcer entre les pratiques des media et ce que l’on fait aujourd’hui relever du care, en y regroupant aussi bien une économie de l’attention, une éthique du souci (de l’autre comme de soi) et une pratique du soin. La notion d’interface est également centrale dans les deux domaines ‒ attestant le fait que le care est médiation et que toute médiation doit impérativement relever du care (faute de quoi elle devient rapidement indéfendable). Ce qui condamne aussi bien les tueurs (fous ou pas) que ceux qui capturent les espoirs ou les frustrations du public dans le court-circuit de l’immédiacie télévisée ou de l’interprétation littéraliste de textes sacrés, c’est qu’ils dissocient médiation et care. Dès lors que tout medium peut s’excéder lui-même, il faut l’utiliser avec soin et prudence, avec méfiance et circonspection – sachant qu’il peut nous blesser aussi bien que nos proches, ce qui requiert donc un excès de travail pour nous en protéger.
Mais c’est pourtant bien dans certains de ses excès qu’il faut travailler à pousser le medium au-delà de lui-même. Ici aussi, l’histoire des appareils scientifiques que Karen Barad met au cœur de sa réflexion mérite de nous inspirer : qu’est-ce que la science moderne – malgré tous ses crimes dus à une prudence insuffisante et à un défaut de care – sinon un effort pour pousser constamment les appareils de mesure au-delà d’eux-mêmes, et pour produire par là-même de nouvelles formes de matières (et de significations) ? C’est le même mouvement qui est celui des artistes envers les différents media dont ils se sont emparés. On pourrait caractériser ce mouvement de recherche, qui pousse les artistes à devenir-un-medium-autre-que-tout-medium-préexistant, comme un approfondissement interne, comme une plongée toujours plus intime dans l’immédialité. Et pourtant, c’est peut-être ici que l’on pourrait retrouver un usage pertinent de l’inter-médialité.
Des craintes parfaitement légitimes envers le « totalitarisme » de l’immédialité peuvent nous faire aspirer à découvrir, à protéger ou à espérer des extériorités envers l’univers matériel-discursif où nous immergent nos media. Pietro Montani a parfaitement raison de souligner le risque de « destitution du monde extérieur comme source de formes » qui nous menace à l’ère des média numériques. « Une image digitale, par exemple, écrit-il, ou un film tout entier n’ont plus besoin de se référer à la contingence du monde visible pour produire une mimésis désormais intégralement planifiée et simulacrale. L’autoréférentialité de la représentation ne cesse de croître et à cette croissance exponentielle correspond une spécialisation croissante de l’aisthesis qui la reçoit ». Prendre soin de notre aisthesis, et de la richesse non-pré-paramétrées des simulations qui lui sont proposées, est en effet une tâche essentielle de la situation présente.
La question est de savoir où situer cette « extériorité » d’où peuvent venir des formes non court-circuitées par l’auto-référentialité de la programmation numérique. Ma suggestion serait de les situer moins dans quelque chose qui serait extérieur à l’immédialité, que dans l’inter-médialité elle-même, au sens où celle-ci décrit un espace intermédiaire entre deux media. C’est peut-être bien dans cet entre-deux que l’aisthesis trouve le mieux à se nourrir – dans les décalages et les déphasages qui distinguent les différents media, dans les taux d’échantillonnage particuliers qui les caractérisent, dans les réglages variables de leurs paramètres, dans les effets Larsen que génèrent à la fois leur proximité et leur séparation, dans les excès et les lacunes de l’un par rapport à l’autre, et dans le travail d’interfaçage qu’on peut avoir à élaborer entre eux. Oui, sans doute, un arbre que je vois et touche dans la forêt constitue une source de formes d’une richesse que ne pourra jamais égaler une photographie digitale. Mais une photographie (digitale ou analogique) constitue elle aussi une source de formes qu’aucun arbre ne pourra égaler (du fait des choix de cadrages, des jeux de lumières, des textures de grains, des circonstances biographiques qui l’ont constituée en image).
La richesse propre des productions audio-visuelles artistiques est de donner à voir à la fois des objets matériels dont les textures et les nuances singulières sont irréductibles aux schèmes intellectuels qui les ont générés intentionnellement et des expériences attentionnelles subjectives face auxquelles le spectateur est conduit à adopter une attitude réflexive et réfléchie envers l’attentionnalité humaine. Regarder un tableau, un film, une série TV, visiter une installation multimedia, jouer à un jeu vidéo, c’est simultanément – et à des degrés variables qui font, bien entendu, la plus ou moins grande richesse de l’expérience en question – explorer l’offre d’une aisthesis matérielle et observer une certaine coupe agentielle de signification qui y a été tracée par une autre attention. Plus précisément encore : c’est faire un va-et-vient plus ou moins constant, plus ou moins enrichissant, plus ou moins intelligemment agencé, entre l’un et l’autre, entre la texture du medium et la pertinence de la médiation.
Trois agentivités immédiales
Depuis plus de deux siècles, la collusion historique entre art moderne et idéologie individualiste a privilégié le rôle de l’artiste producteur dans l’émergence des expériences artistiques. C’est son excès de travail (ou de sensibilité) avec le medium qui a été conçu comme responsable des effets induits par l’œuvre artistique. Depuis un demi-siècle, à la lumière convergente des théories institutionnelles de l’art inspirées par Duchamp, des pratiques des usagers analysées par Michel de Certeau et des réflexions littéraires sur la reader-response theory, l’agentivité des récepteurs a commencé à être davantage prise en compte. Dans un ouvrage récent, Jean-Marie Schaeffer situe le cœur de l’expérience esthétique dans un certain « style attentionnel », que les cognitivistes ont qualifié de « divergent » : au lieu de chercher à intégrer (aussi rapidement que possible) des stimuli dans des schèmes identifiés sur la base de simplifications, de cohérences et de hiérarchisations (ce qui caractérise le style attentionnel convergent, standard de nos pratiques quotidiennes), le style attentionnel esthétique se caractérise par une tendance à la fragmentation spatiale, à la dispersion, à la dé-hiérarchisation, nous rendant sensibles aux détails insignifiants, aux nuances à peine perceptibles et aux hétérogénéités.
C’est ici un excès d’attention de la part du récepteur qui apparaît comme producteur de l’expérience esthétique, laquelle a dès lors pour pré-condition une attitude anti-économique de surinvestissement attentionnel, de dépense excessive, de ralentissement et d’acceptation de « retard de catégorisation » : selon un modèle finalement très kantien, il ne peut y avoir d’expérience esthétique que dans la mesure où j’accepte de ne pas reconnaître à travers un « jugement déterminant » ce que j’ai sous les yeux, c’est-à-dire dans la mesure où je dispose du temps nécessaire à suspendre mes catégorisations préexistantes pour faire émerger un nouveau jugement « réfléchissant ». Alors que l’agentivité de l’artiste instaure un écart entre ce que pouvait le medium et ce que l’artiste le pousse à faire, l’agentivité du récepteur instaure un écart entre ce que la circulation du medium devait déclencher selon les catégorisations qui ont dominé sa mise en circulation et ce qu’un surplus d’attention peut y faire apparaître dans l’espace suspendu d’un retard de catégorisation.
Il est pourtant une troisième agentivité qui se situe au plus près des coupes agentielles théorisées par Karen Barad, et que rendent de plus en plus centrale une série de théoriciens émergés au cours des dernières décennies, de la Théorie du film de Siegfried Kracauer et de la Philosophie de la photographie de Vilém Flusser à l’archéologie des media de Friedrich Kittler, Wolfgang Ernst et Siegfried Zielinski. C’est peut-être la philosophie esthétique de Pierre-Damien Huyghe qui a le plus clairement synthétisé cette agentivité des appareils, émanant de leur capacité à excéder, par leur automatisme même, les programmations intentionnelles au sein desquels on aura voulu les contraindre. On peut articuler sommairement cette troisième forme d’agentivité en quatre points :
1° Au lieu de traiter un dispositif technique comme une machine, c’est-à-dire comme l’instrument d’une opération programmée dans tous ses paramètres pertinents, dont le déroulement idéal sera strictement conforme à sa préméditation, on peut traiter ce dispositif comme un appareil, c’est-à-dire, pour le cas des media, comme un système d’inscription dont le résultat échappera nécessairement à la programmation qui l’aura paramétré. « Ce que donne un appareil, lorsqu’il n’est pas engoncé dans une quelconque logique d’instrumentation, ce qui, donc, appartient à sa puissance spécifique, échappe, dans un certain laps de temps au moins, à ce qui peut être envisagé, dessiné, calculé, prévu, etc. ». C’est bien à cette propriété de l’appareil-photo que faisait référence André Bazin dans son article de 1945 en affirmant que, « pour la première fois, une image du monde extérieur se forme automatiquement, sans intervention créatrice de l’homme, selon un déterminisme rigoureux ».
2° La puissance originale d’un medium ne tient pas aux contenus qu’il peut enregistrer, transmettre ou transformer en tant que machine mise au service d’un programme de communication, mais aux différentes formes de bruit auxquelles son fonctionnement propre permet de se rendre sensible. En répétant que la principale nouveauté apportée par le gramophone a été de permettre l’inscription de ce « réel » qu’est le « bruit » au sein des systèmes d’information humains, Friedrich Kittler formulait un axiome fondamental de l’agentivité des appareils : leur vertu première tient à leur capacité de faire apparaître à nos sens des dimension de notre aisthesis habituellement neutralisées par nos limitations sensorielles et/ou par nos habitudes perceptivo-cognitives. Dans le court-circuit opéré par les appareils, « point de modulation subjective au fur et à mesure de l’expérience, point de travail d’entendement pour rapporter le perçu à des concepts, point d’assignation du sensible à des catégories, seulement des dispositions sensibles réglables ».
3° En court-circuitant nos imaginations subjectives, en donnant momentanément la parole au bruit, les appareils permettent de déchirer localement le voile des imaginations toujours un peu idéologiques qui filtrent nécessairement toutes nos perceptions du monde, telles qu’elles sont programmées en nous par les valeurs régissant nos systèmes de communication et de collaboration dominants. L’agentivité des appareils nous invite à utiliser les dispositifs médiatiques pour opérer des coupes inédites et inouïes, qui donnent matière à des bouts de réel saisis par l’appareil en tant que bruit, mais porteurs de perceptions (et potentiellement de significations) susceptibles de déchirer le voile des idéologies dominantes.
4° Il y a médiartivisme lorsqu’est sollicitée une telle coupe agentielle émanant des propriétés incontrôlables des appareils. Dans les termes proposés par Pierre-Damien Huyghe sur le cas d’un art particulier, il y a cinéma dans un film – et de plus en plus de nos films sont presque totalement dépourvus de cinéma – lorsque cette condition est satisfaite est satisfaite : « Que se passe-t-il quand le cinéma pointe dans un film ? Rien que de très insignifiant, […] un morceau de réalité brute de fiction. Rendre cet insignifiant digne d’une parution, tenir sa présence pour quelque chose, l’exposer dans le montage, telle est, dans l’économie des films, l’affaire propre, ni représentative ni littéraire, du cinéma. […] Tout l’art du cinéma consiste à maintenir dans le produit projeté les droits de la réalisation. Les exemples de réussite ne manquent pas mais sont essentiellement localisés. Le cinéma se montre comme une sorte d’exception au jeu des puissances qui attendent, demandent et finalement règlent un certain genre projetable d’enchaînement de plans et de séquences ».
L’intra-action immédiale dépend des articulations complexes qui s’établissent entre ces trois formes d’agentivité. Nul ne peut vraiment prédire ni quand « réussira » un effort intentionnel d’« instauration de transformations itératives dans des pratiques particulières », ni quels effets précis ces transformations pourront avoir. C’est bien entre ces différents excès insérés au cœur même de l’immédialité que se jouent nos transformations sociales. Les coupes agentielles opérées par les appareils médiatiques à l’occasion de nos expériences esthétiques ne vont pas chercher des réalités ontologiquement extérieures à celles qui (se) nourrissent (de) notre immédialité. Elles instaurent d’autres matérialisations-significations en son sein, en excédant les capacités antérieures des coupes précédentes et – dans les meilleurs des cas, rares mais précieux – en contribuant à des reconfigurations productrices de changements itératifs et à l’émergence de matières et de significations mieux à même de nous faire mener des vies davantage soutenables et exaltantes.