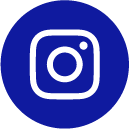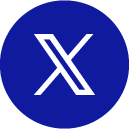Comment partir d’une démarche sensible et empirique pour appréhender la performance et le dispositif ? C’est la question que je me suis posée quand on m’a proposé d’enseigner un cours intitulé «Dispositifs et performances artistiques» au sein du Master ArTeC. Ma première intuition a été de transformer ce cours en «atelier» pour que ce soit à partir du faire et de l’expérimentation que du sens puisse se dégager. En tant qu’artiste plasticienne je réalise combien il serait difficile et vain dans ma pratique d’essayer de dissocier geste artistique et réflexivité. C’est dans la réciprocité des deux que les formes et les savoirs émergent. Je me rapproche en cela de la pensée de Tim Ingold qui dans son livre Making (2013) voit la création comme une confluence de flux, d’énergies et de matériaux, comme un processus «morphogénétique» plutôt qu’«hylémorphique ». Du grec hylè (matière) et morphè (forme), l’hylémorphisme est la théorie selon laquelle la forme est dictée par l’esprit de la personne qui la façonne. À l’inverse de ce modèle où l’artiste se tient à l’écart du monde et où ses idées prévalent sur la matière, l’approche «morphogénétique» se situe dans un champ de forces déjà en cours. L’artiste entre alors en relation avec la matière et d’autres agents, unit ses forces avec eux, intervient et participe plutôt que dicte. Cette façon de penser la création et la théorie non plus comme un projet planifié à l’avance mais comme une intervention qui s’improvise et se cherche a beaucoup inspiré ma façon d’imaginer ces ateliers. Ne connaissant pas les personnes qui allaient participer, j’ai imaginé une structure qui laisse place à l’improvisation. Chaque séance était pensée autour d’une problématique que nous allions aborder par le geste, parfois en étant accompagné·e·s d’un·e praticien·ne invité·e. À travers la diversité de ces propositions j’espérais pouvoir répondre à la curiosité et à la sensibilité de personnes que j’allais bientôt rencontrer et dont les pratiques étaient nécessairement variées.
Atelier 1 : les prémices d’une communauté
La première séance était très importante car elle consistait à poser les bases d’un espace commun et participatif. C’était notre premier contact, et je voulais faire connaissance d’une façon plus souple que dans le dispositif de la « classe » avec ses tables, ses chaises, souvent orientées dans une seule et même direction. Il me semblait important de changer ce dispositif pour plusieurs raisons :
- La première est liée à ce que j’ai énoncé plus haut : si l’émergence d’un savoir nécessite d’entrer en collaboration avec d’autres agents de façon ouverte et improvisée, la hiérarchie élève-professeure induite par la disposition de la salle de classe traditionnelle n’est plus vraiment opérationnelle. Il fallait chercher une autre configuration, où ma position et mes intentions pédagogiques ne prennent pas le pas sur l’agentivité du groupe.
- La deuxième raison concerne la dynamique des séances, que je n’aurais tout simplement pas pu porter seule. Dans son livre Apprendre à transgresser, l’éducation comme pratique de la liberté (1994), Bell Hooks souligne très bien ce problème. L’enthousiasme et le plaisir d’apprendre se cherchent et se trouvent ensemble, dans un effort collectif, ce qui là encore décentralise la position du·de la professeur·e qui n’est plus seul·e responsable de la vitalité du cours.
- La troisième raison, la plus importante à mes yeux et la plus difficile à travailler, se situe dans l’hétérogénéité du groupe. Je suis très sensible au travail de Carol Gilligan, qui, depuis son livre In a different voice (1982), a montré combien la voix pouvait se révéler fragile face aux mécanismes de hiérarchisation et de division qui se mettent en place très tôt dans la société, en particulier à l’école. À partir de ce constat, comment construire un espace capable d’accueillir la singularité de chaque personne ? Il a fallu tenter de nous mettre au même niveau, afin que chacun·e puisse participer, quels que soient sa provenance, son expérience, son parcours. Former une communauté d’apprentissage où chaque voix est entendue et reconnue était d’autant plus nécessaire que nous allions prendre des risques ensemble et nous mettre à nu lors de certains ateliers comme celui de l’improvisation vocale avec Claire Serres ou de l’initiation au drag avec tata Foxie.
Ma première intuition a été de changer la disposition de la salle qui nous était destinée au Campus Condorcet. Nous avons enlevé les chaises et les tables, et disposé de grand rectangles de tissus colorés au sol, de façon à créer des îlots qui puissent se regarder et se toucher.
J’ai aussi proposé un rituel que nous serions amené·e·s à renouveler au début de chaque séance : la préparation du thé. Tout comme la mise en place de la salle, ce rituel constituait les prémices de notre communauté car il nous poussait à nous organiser à travers des gestes simples (chercher de l’eau aux toilettes, lancer la bouilloire, marquer le nom de chaque personne sur les verres, servir le thé…). Puis nous nous sommes assi·se·s en petits groupes sur ces étendues de couleur et nous avons pioché des questions que j’avais préalablement écrites sur des bouts de papier. Des conversations se sont ainsi engagées entre les personnes, ce qui nous a permis de nous rencontrer de façon simple et ludique (les questions posées étant à la fois drôles, sérieuses et bizarres).
Nous avons ensuite fabriqué une image qui nous représentait avec différents papiers de couleur. Nous avons inscrit dessus notre·nos prénom·s et le·les pronom·s personnel·s au·x·quel·s nous nous identifions. J’ai senti qu’à travers la fabrication de cette image et les questions soulevées par nos prénoms et pronoms un espace propice à la parole était possible. Nous avons évoqué la peur que pouvait susciter ces premiers tours de parole dans une classe, et certaines personnes ont exprimé leur contentement à ne pas évoquer leur projet universitaire. Elles se sont mises à parler d’autre chose. Je me souviens avoir communiqué sur mes cheveux, parce qu’ils se sont révélés très présents dans mon image. Une autre personne s’est mise à interroger ses multiples identités que son prénom ne semblait apparemment pas contenir. Elle s’est mise à inscrire une multitude d’autres prénoms sur son image et nous a dit que nous pouvions choisir, ou même lui en inventer un autre. Ces images et ces discussions ont généré du lien entre nous. C’est comme si on avait ouvert une partie de nous-même au groupe. Même infime, cette ouverture était présente à travers chaque image, que nous avons assemblé ensemble sur un long papier et que nous avons accroché au mur. Cette frise disparate et mystérieuse (les images souvent abstraites n’avaient de sens que pour nous-mêmes) nous a un peu rappelé l’école maternelle, et renvoyé à ces premiers moments de socialisation. De l’accrocher au mur fut un autre geste-rituel, que nous avons acté au début de chaque séance, avec le thé et l’agencement de l’espace.
Atelier 2 : performer la fiction-panier

La deuxième séance s’est construite autour de La théorie de la fiction-panier, un texte où Ursula K. Le Guin se positionne face aux grands récits héroïques et triomphants de l’Homme (au singulier et au masculin). En invoquant la figure du panier, elle y développe avec beaucoup d’humour sa stratégie pour contrer ce modèle de récit unilatéral. C’est dans la répétition du geste et dans la collecte de petites choses à première vue insignifiantes et disparates, qu’il est possible de (re)donner vie aux histoires. Cette façon d’imager l’écriture et de la penser comme un processus où les mots s’agencent ensemble comme des choses, coïncide avec la pensée de Tim Ingold sur la nécessité du faire dans la recherche-création ; le panier est d’ailleurs quelque chose qu’il a expérimenté lors d’un cours avec ses étudiant·e·s.
Alors que je présentais le texte de Le Guin, un malentendu s’est produit. J’ai proposé que nous le lisions ensemble, c’est-à-dire l’un·e après l’autre, mais une personne a compris que nous allions le lire tou·te·s en même temps. Qu’à cela ne tienne, je propose que nous l’essayions. Cette lecture en chœur fut surprenante… pour ma part à la fois pénible et jubilatoire. Dans les notes que j’ai prises à la suite de cet atelier, j’écris :
« j’aurais aimé avoir plus de temps pour approfondir cette lecture-performance : une personne aurait pu commencer à lire le 1er paragraphe, puis une autre aurait pu entrer dans la lecture à partir du 2e paragraphe, et ainsi de suite. Peut-être que cela nous aurait aidé à moduler le volume et le rythme de nos voix ? Car un rythme s’est imposé de lui-même, un peu trop rapide et difficile à suivre. Et puis l’émotion de lire ensemble serait peut-être montée plus graduellement. Parce que personnellement j’ai adoré cette lecture collective. J’ai adoré chercher ma concentration avec toutes ces voix autour, en particulier la voix qui était à ma gauche et à ma droite. Un micro-moment dont je me souviens et qui est lié à ce problème de rythme que nous avons rencontré : il m’est arrivée d’être essoufflée, et je me suis alors appuyée sur la voix de Matteo qui était à ma gauche pour me reposer et l’écouter. J’ai alors pu reprendre là où je le pouvais. C’était très chouette de pouvoir faire ça et cela m’a fait penser à la pratique de l’arpentage (1). J’ai beaucoup aimé les moments où l’on tournait une page ou que l’on changeait de paragraphe. Tout à coup on pouvait à nouveau se synchroniser et je ressentais la volonté de chacun·e d’attendre les autres, de se remettre à niveau. J’ai aussi été sensible aux décalages. Ils n’étaient pas forcément plaisants mais ils parlaient de la difficulté d’être un groupe, et du besoin d’être dans une écoute accrue et amplifiée pour laisser la place à l’autre et pour entendre sa propre voix. C’était un bel échec. Un échec qui donne envie de continuer à chercher. Autre souvenir : les moments de rire à la lecture du texte. C’était très émouvant de partager ce rire. Alors que je riais pour moi-même, j’entendais celui des autres, et ça me faisait rire de plus belle (2)».
Après cette lecture nous avons fait des paniers par groupe de deux-trois personnes. J’ai projeté un tuto sur Youtube que j’avais moi-même suivi quelques jours auparavant pour tester ce que j’allais proposer. Là encore il a fallu nous organiser : couper des grands pans de carton en lanière, identifier les autres matériaux que nous avions apporté et que nous allions tresser avec ce carton. Quelques personnes ont décidé de faire leur panier seules malgré ma proposition de se mettre en groupe. Au bout d’un quart d’heure voyant que leur panier ne serait jamais terminé à temps elles ont rejoint un groupe. Le panier était alors abandonné ou récupéré pour la fabrication du nouveau panier. C’était un constat intéressant de voir qu’il était nécessaire de travailler en collaboration pour aller au bout de l’exercice. À une exception près : Hong est restée seule et semblait très à l’aise. C’est elle qui a fait le plus grand panier : à la fois haut et large avec une base de tissu rouge orangé. Je me souviens de son geste pour mimer la pêche en mer avec son panier terminé. Les résultats étaient surprenants. Ils révélaient la personnalité des personnes et la façon dont les binômes s’étaient accordés. J’ai senti un mélange de fierté et d’émerveillement à voir ces formes se matérialiser en si peu de temps : des paniers plus ou moins serrés, colorés et texturés, incorporant parfois des éléments hétéroclites comme des câbles et des petits objets. Certains n’étaient plus vraiment des paniers, comme avec l’énorme chapeau-chevelure de Diane et Younès que l’on pouvait placer sur sa tête. J’avais ajouté la contrainte lors de l’exercice de se raconter des histoires : une prise de risque et/ou l’expérience d’un échec. Dans les textes que les personnes ont écrit à l’issue de cet atelier, les récits laissent entendre que les paniers n’étaient pas seulement issus de mouvements et de gestes, mais qu’ils avaient aussi pris la forme des conversations. Cette expérience a fait écho au texte de Ursula K. Le Guin que nous avions lu juste avant. Les paniers que nous avions entre les mains (ou sur la tête) n’avaient rien d’héroïque. Leur aspect singulier et fragile, issu de paroles et de gestes hésitants, exprimaient quelque chose de l’écriture bancale et discontinue mise en avant par Le Guin.
Cet atelier nous a aussi permis de discuter de l’outil drive que nous allions commencer à utiliser. Les paniers étaient comme la métaphore de ce que nous allions mettre en commun et ramener ensuite à la maison ou dans nos pratiques. Voyant que nous allions manquer de temps pour prendre des notes à la fin de chaque séance comme je l’avais prévu, j’ai proposé que nous écrivions ces notes dans cet espace, entre les ateliers. Cette idée a marché pour certaines personnes qui s’en sont emparées, moins pour d’autres. Mais le partage d’un panier-drive permettait à tout le monde de lire ce que chaque personne écrivait, et donc de participer même sans avoir à écrire.
Atelier 3 : «Chœurs, Souffles, Voix» avec Claire Serres

J’ai invité la performeuse et compositrice Claire Serres à proposer un atelier d’improvisation vocale. Claire est à l'origine du projet Sirène Song, une association qui organise des groupes de recherche vocale autour du geste, de l'énergie et du chant improvisé. Elle a fondé le chœur de femmes les Serpentes avec qui elle compose régulièrement des performances et des pièces sonores. Voici ce que disent mes notes partagées sur le drive :
« Claire nous a proposé de “chanter”. C’est-à-dire de sortir nos voix (elle parle de la voix au pluriel) sans réfléchir et ensemble. J’ai eu peur. J’ai toujours peur quand je performe, même dans un contexte bienveillant. Quand Claire a proposé de produire un “geste chanté” au reste du groupe, que l’on devait reprendre ensuite tou·te·s ensemble, j’ai senti une boule dans mon ventre et mon visage s’échauffer. Et en même temps j’avais confiance dans le fait que nous étions dans le même bateau. C’était magique de voir que chacun·e s’en sortait… et chaque geste était tellement drôle et unique. Il faut dire que Claire a su nous mettre à l’aise, le geste qu’elle a proposé était complètement ridicule. Après ça nous ne pouvions pas faire pire...
Et puis nous avons improvisé ensemble. C’était difficile mais ça marchait toujours, même quand il y avait des problèmes d’écoute, de panne d’inspiration, d’ennui ou d’inhibition. J’ai essayé de ne pas paniquer quand je n’avais rien à “dire”. J’ai aussi essayé de ne pas recouvrir toutes les voix quand je me mettais à partir dans des phrases étranges qui m’emportaient tout à coup. Parfois j’ouvrais les yeux et je reconnaissais les personnes, ça me distançait de la situation. Parfois j’avais un peu honte de ce que j’étais en train de faire. Honte de quoi ? D’être ridicule, ce qui sortait n’était pas contrôlé. C’était à la fois plaisant et effrayant. Les sons que nous avons produits étaient différents du langage parlé, de la voix posée, du style ou de la façon dont nous avons l’habitude de nous exprimer. C’est comme si quelque chose d’invisible se mettait à “parler”. Un autre “moi”, plus profond, moins contrôlé. Quand j’arrivais à lâcher prise j’étais tout à coup plus à l’écoute des autres voix. Ce sont souvent elles qui me donnaient envie de m’exprimer. Un petit chat timide quelque part, une plainte, des bruits étranges venant de quelque part et n’appartenant à aucune identité fixe. C’était comme un paysage sonore. Deux personnes ont évoqué lors du “cercle de parole” la sensation en arrivant dans la salle que de la musique était jouée d’un ordinateur, des nappes. Je me suis dit que c’était une belle façon d’être ensemble : ne pas dominer l’espace sonore mais chercher à se fondre. Cela me fait penser à d’autres moments encore, lorsque nous improvisions et que certaines voix prenaient tout à coup tout l’espace. À l’inverse de la nappe sonore ces événements bien distincts permettaient de sortir d’un état, d’aller ailleurs. La voix de la personne exprimant quelque chose de bien audible modifiait tout à coup l’ambiance ou la couleur, entraînant les autres vers un autre état ou atmosphère. Et ça me pose plein de questions sur la façon de trouver sa place au sein d’un groupe. Les voix les plus fortes, les plus présentes, sont importantes car elles sont des forces entraînantes tant qu’elles ne recouvrent pas les autres. Il me semble que c’est aussi en laissant de l’espace vacant que les voix qui portent moins, ou qui s’expriment différemment (des chuchotements par exemple) peuvent exister et devenir des forces entraînantes elles aussi. Cet équilibre demande de la pratique. Comment des énergies parfois radicalement différentes peuvent-elles arriver à co-exister ?
J’ai aimé l’exercice où nous nous sommes passé·e·s le son pour ne jamais le laisser s’éteindre. Il y avait une certaine douceur à faire cela. Une attention portée au son. Claire a aussi orienté notre attention sur nos périnées et diaphragmes, deux parties du corps permettant de soutenir l’énergie et la voix (3) ».
Atelier 4 : «Se (la) raconter par le maquillage, le vêtement et le mouvement » avec Tata Foxie

Tata Foxie, drag queen et conteuse nous a proposé un atelier d’initiation au drag. Elle fait partie du collectif Paillettes réunissant, comme il aime à se définir, « drag queens, travelottes et créatures parisiennes ». À travers la lecture de contes, le collectif explore avec les enfants les questions d’inclusion, d’égalité et interroge la normalisation. Je partage ici les notes qu’une personne a déposé sur le drive à l’issue de cet atelier :
« Je suis arrivée cet après-midi sans appréhension particulière, mais plutôt avec une petite excitation, comme une envie de fête à l'idée d'enfin prendre le temps et avoir un espace et un groupe avec qui essayer pour la première fois ce type de performance que je n'avais auparavant observée que de loin. En voyant Foxie en face pour la première fois, je sens de la tension en elle, qui s'ouvre à nous d'une façon dont elle n'a visiblement pas l'habitude. Elle accepte de montrer un gros morceau d'elle en partageant un bout de son histoire et en se maquillant en étant épiée par nos regards naïfs, curieux ou interrogateurs.
Lorsqu'en introduction à cette séance, lors de notre premier cercle, Foxie propose de se tenir les mains et d'invoquer d'autres personnes avec nous, des images défilent dans ma pensée et j'ai la gorge nouée. Je n'ai pas pu les appeler à voix haute à ce moment-là mais je le regrette un peu alors je vais vous les présenter ici à l'écrit.
J'ai évidemment pensé à mon arrière-grand-mère dès qu'il fût question d'invocation. Elle s'appelait Marguerite et elle détestait son prénom car selon elle c'était un prénom de vache. J'aurais aimé qu'elle ait l'occasion de se renommer ou bien de jouer de cette image de vache en faisant du drag. Je l'invoque bien qu'elle soit décédée peu avant ma naissance parce qu'on dit de moi que je suis sa réincarnation, parce que j'ai grandi en écoutant ma mère parler d'elle, et qu'apparament c'était une femme merveilleuse. C'était une sorcière et une grande esthète : elle ne vivait que pour le beau, le grandiose, et toute chose, si petite soit-elle, qui puisse la faire vibrer.
J'ai également pensé à mon ami Alexis et surtout à Vanitea (son nom de drag queen), et au fait que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus.
Enfin, à ma propre surprise j'ai pensé à Barbara (oui la chanteuse, celle de l'Aigle noir, avec son piano) parce qu'elle est réapparue récemment dans ma vie, lorsque je me suis coupé les cheveux très courts et que l'on m'a comparé à elle "mais en plus jolie" au salon de coiffure, parce que j'avais ces cheveux bruns très courts et un eye-liner noir, très marqué et complexe, mais aussi apparemment son style et sa prestance. Je ne serais jamais allée aussi loin, mais j'ai accepté le compliment. Bien que cet échange ait eu lieu il y a quelques semaines déjà, je m'en souviens encore parfaitement tant il m'a chamboulée. J'avais l'impression en rentrant chez moi ce jour-là d'être habitée par un personnage et de marcher fièrement sur un catwalk.
Pendant l'atelier, j'ai évidemment eu des moments de doute, de flottement où je ne savais pas par quel bout commencer, quoi faire, comment, où me mettre ? Mais au fil de ces trois heures, tout se débloque naturellement. J'ai senti se construire une confiance en moi que je ne connaissais pas. Lorsque que j'ai entendu Foxie et Judith parler de se démaquiller et ranger, c'est là que je me suis sentie la plus déstabilisée, je n'avais pas envie de quitter cette identité que je venais tout juste de créer ! Et juste après, en rangeant, on demande à échanger et je ne peux dire qu'une chose : je me sens nue.
Pendant ces trois heures j'ai oublié mon état initial, de façon même assez littérale. Je suis venue un peu fatiguée et avec un mal de gorge mais je ne l'ai plus du tout ressenti dès le moment où je me suis mise à phaser en me maquillant, et puis tout du long jusqu'à arriver chez moi ce soir. Alors bon je suis maintenant proprement démaquillée, en pyjama. J'aurais voulu continuer la fête ce soir à la Mutinerie mais ce ne serait pas raisonnable, je vais enrayer mon mal de gorge avec un phó en regardant RuPaul's Drag Race, c'est déjà une assez bonne continuité pour le moment.
Cependant je n'oublie pas ce que c'était que d'être si grande et si déséquilibrée sur ces talons trop hauts, trop grands, trop brillants, dans une robe bouffante, d'exagérer ma voix que j'ai toujours trouvée trop aiguë et de défiler, en étant si maladroite et en même temps si grande. (4)».
Atelier 5 : « Guimauver le monde : comment penser un monde utopique à travers la matière du marshmallow ? » avec Fanny Aboulker
Performeureuse, tisseureuse, vidéaste et travailleureuse de texte, Fanny Aboulker a fait le DIU ArTeC + en 2019/2020 avec moi. Iel fait désormais une thèse en recherche-création à l’UQAM à Montréal sur la question du neutre dans la langue française. Voici une partie de mes notes partagées sur le drive:
« J’attendais cet atelier avec impatience. Autant pour ses contraintes (Fanny étant avec nous par Zoom) que pour son contenu. Fantasmer un monde utopique ça m’intéresse énormément. Nous avions très envie d’entendre les personnes de cet atelier déployer leur imaginaire et assembler bout par bout des images et des rêves issus de leur rapport au réel parfois violent ou déceptif (les rêves émergeant de ce qui coince ou résiste, un peu à l’image des problèmes qu’on a eu sur Zoom). Comme d’habitude, le temps nous a manqué pour vraiment y parvenir et je n’avais pas anticipé les problèmes d’interférence de son sur Zoom. Je pense aussi que j’aurais dû tout de suite placer mon téléphone sur la table dans une position où Fanny aurait pu voir les personnes de plus près lors de sa présentation. Iel n’avait qu’une vue générale et informe du groupe via mon ordinateur et ne pouvait percevoir l’expressivité de nos voix et de nos visages. Cela a créé une distance entre nous dès le départ qui aurait pu être amoindrie. Je ne sais pas si la “mise en bouche” de son atelier par une lecture collective a fonctionné. L’idée était d’entrer un peu tou·te·s ensemble dans son univers... Malheureusement je n’ai pas réussi à trouver de marshmallows vegans le matin et j’ai oublié d’apporter un autre type de bonbon. Du coup de mon côté ça n’était pas très fructueux cette lecture avec un morceau de banane dans la bouche.
Nous avons travaillé à partir de marshmallows à base de gélatine, que j’ai achetés en grande quantité. Je pense que pour Fanny, les problèmes que cela peut poser font partie intégrante du réel, et travailler à partir d’un matériau ambigu (doux et violent à la fois) est intéressant pour iel. Pendant le confinement en 2020 nous avons formé un groupe de lecture et nous avons lu entre autres Staying with the trouble de Donna Haraway. Pendant trois mois ce livre nous encourageait à faire de la SF (Science-Fiction, Speculative Fabulation, String Figures, etc... Haraway joue sur la polysémie du terme SF) à partir des problèmes présents. Il nous enjoignait à nous emparer de ces problèmes, à les transformer par le recours à la fiction.
Je suis vegane depuis deux ans, végétarienne depuis six, et j’ai réalisé en préparant l’atelier que je mettais mes valeurs et ma sensibilité de côté. Le budget dont je dispose ne m’a pas permis d’acheter des marshmallows vegans pour une telle quantité. Lorsque je réfléchis à ce problème, je me dis qu’il est symptomatique d’un problème bien plus large dans notre société. La forme séduisante et trompeuse de ces bouts de viande m’a permis d’aller à l’encontre d’une éthique pourtant bien ancrée chez moi. Si Fanny m’avait proposé de travailler avec de la viande hachée, aurais-je pu le faire ? Bien sûr que non. C’est un aspect de l’atelier que j’ai trouvé très problématique mais néanmoins intéressant. Nous devions imaginer un monde sans violence avec un matériau issu d’un processus très violent. Cela me fait penser au livre Cruiser l’utopie (2008) de José Esteban Muños qui est toujours avec nous dans la salle de classe, et qui parle de l’utopie comme un espoir impossible, forcément déceptif, car les conditions ne sont pas encore propices, pas encore présentes pour que l’espoir se réalise. C’est aussi ce que je ressens lorsque je suis face au travail de Fanny : la violence à partir de laquelle elle travaille produit des choses douces, réparatrices, mais qui sont doubles car elles contiennent encore de la violence. La violence est contenue dans la douceur qu’elle émet et c’est à partir de cette violence que la douceur se fabrique.
Lorsque j’ai observé le monde marshmallow en train de se faire, j’ai pu voir en quoi il était loin d’être rose. La sculpture d’Emilio*x a été jetée par inadvertance et certains marshmallows étaient “violentés” par contorsion. En lisant Malo tout à l’heure j’ai trouvé intéressant de voir que ce monde exprimait de la rage, de la frustration, du conflit, et que cette colère se mêlait à beaucoup de douceur avec ce grand berceau coloré, cet instrument chinois, ce nid-refuge, ce train vers la Suisse, et que tout cela était peuplé de petits personnages très mignons (cf. la vidéo où j’interroge Diane ou encore les personnages de Han). Une autre chose m’a particulièrement frappée lors de l’atelier : les rires. Il y avait beaucoup de plaisir sur les visages, et beaucoup de complicité entre les personnes.
J’ai aussi été sensible au fait que ce monde s’est construit collectivement. C’était beau de voir les téléphones connectés au Zoom passer de mains en mains, déployant une multiplicité de points de vue en simultané. Comme l’a souligné Minghao dans ses notes, les personnes étaient à la fois “actrices, vidéastes et spectatrices”. Les problèmes rencontrés avec Zoom se sont eux aussi réglés en symbiose et j’ai l’impression que cela n’aurait pas été possible au début du semestre. L’échange entre Fanny et les personnes est devenu de plus en plus fluide grâce au système d’alternance entre les micros et les enceintes que nous avons finalement trouvé.
Cette cohésion et la facilité avec laquelle chaque personne s’est mise à (re)donner vie aux marshmallows (morts) nous aurait permis d’aller très loin. Nous avions prévu de terminer l’atelier à travers un jeu conversationnel : comment apprend-on dans un monde en guimauve ? Est-ce qu’il y a des écoles ? Et si oui comment fonctionnent-elles ? Le mariage existe-il ? Sous quelles formes est vécu l’amour ? Comment meurt-on dans un monde en marshmallows ? Où vivent les malades et les vieilles personnes ? Ou vont les corps une fois morts ? Comment célèbre-t-on la mort ?
Je suis déçue que nous n’ayons pas eu le temps de faire cet exercice, qui aurait été la mise en mot d’une pensée nouvelle, l'émergence d’une réflexion encore hésitante mais qui aurait ouvert des pistes incroyablement riches pour questionner notre réalité présente. Et je sais combien les personnes se seraient emparées de ces questions, auraient imaginé des chose incroyables... j’ai besoin d’en parler ici car j’ai vécu la contrainte du temps à laquelle nous sommes si souvent confronté·e·s lors de cet atelier comme une véritable barrière. C’est comme si nous avions dû nous arrêter en cours de route lors de la fabrication des paniers et quitter la pièce sans les avoir terminés. J’ai l’impression que nous étions prêt·e·s à développer des images, des rêves, des idées, et que nous avons dû tout remballer et nous dire aurevoir avant même d’entrer dans une conversation passionnante. L’élaboration du monde utopique que Fanny nous proposait d’imaginer est restée en suspens. Et les formes en marshmallow sont privées d’un sens que nous aurions pu trouver ensemble. C’est une grosse déception. Peut-être que la prochaine séance à l’Ehpad sera l’occasion de transformer cet échec. Je la vois comme une seconde chance, non pas pour rattraper ce qui a manqué mais pour donner un second souffle à notre atelier. Je suis heureuse que nous ayons cette possibilité, car comme souvent l’itération est nécessaire pour aller plus loin et tenter de comprendre ce que l’on est en train de faire (5)».
Atelier 6 : « Guimauver le monde» avec les résident·e·s de l’Ehpad Furtado Heine

J’ai proposé une séance dans l’Ehpad de la Ville de Paris où je développe actuellement des ateliers artistiques. L’idée était de déplacer l’expérience vécue avec Fanny Aboulker lors de la séance précédente, et de laisser le groupe animer cet atelier. Voici un assemblage réalisé à partir de fragments des textes déposés dans le drive par ces personnes :
« J’arrive à l’Ehpad sans attentes particulières, mais avec une certaine appréhension : je ne sais pas trop si je parviendrai à amener quelque chose de particulier à cet atelier, et je sais d’avance que je ne pourrai être à l’aise avec les résidents qu’avec l’aide d’autres camarades. De plus, je ne suis pas très convaincue de l’usage des marshmallows, même si c’est censé être la pièce maîtresse de cet atelier. Imaginer un monde merveilleux, une sorte d’utopie de cette manière me paraît forcé. Je trouve ça tellement en décalage avec la réalité, dont l’impact est si fort dans des lieux comme un Ehpad.
On va dans une maison de retraite et puis quoi ? Apprendre aux personnes âgées à créer avec des marshmallows ? Serai-je capable de communiquer avec eux/elles ? En tant qu'étrangère, communiquer avec des personnes dans une langue non maternelle est une chose difficile en soi, et sera-t-il encore plus difficile de communiquer avec les personnes âgées ?
Après avoir posé quelques questions « artificielles » qui n'ont pas réellement reçu de réponses, je réalisais que pour espérer entrer en contact avec elles, il ne fallait pas intellectualiser quoi que ce soit, mais plutôt rester spontané et disponible. A partir de ce moment-là, j'ai fait ce que j'avais envie, j'ai joué du piano avec Emilio, fait le grand écart avec Pauline pour une résidente en fauteuil roulant, dansé avec elles/eux, etc... C'est seulement à partir de ces moments que j'ai vraiment eu la sensation de partager quelque chose, de créer un lien.
Ensuite je me suis déposée sur une autre table, avec 3-4 résidentes de l'Ehpad et Alissa. Ça tripotait des guimauves, des bâtons, des fils. J’ai aidé une femme malvoyante à construire son bonhomme de guimauves. Elle était vivante, chaleureuse et heureuse. À un moment Emilio nous rejoint et comme nous étions assez, je décide de partir vers la prochaine table. Younès jouait à un domino effréné avec trois dames. Il a eu envie d’aller jouer au piano, je l’ai remplacé. Cette activité était bien pour mon humeur du jour, directe, simple, rapide et pas le temps de réfléchir avec ces femmes qui sautaient vite mon tour si jamais je ne réagissais pas.
Les deux autres femmes âgées ne voulaient toujours pas me parler, sauf Mme F, qui m'a d'abord demandé ce qu'il y avait sur la table. Je désigne tout : il y a du tissu, du papier épais, des lacets, de l'eau, du fil et de l'aiguille, des guimauves. Elle a demandé “c'est quoi ça ?”, je lui ai répondu “ça dépend de vous, on peut les utiliser ensemble pour réaliser ce que vous voulez”. Elle a dit que ce n'était pas l'après-midi qu'elle voulait, il semblait qu'elle attendait beaucoup, l'expérience après son arrivée dans la salle ne semblait pas répondre à ses attentes, elle a dit : “ça rien”. Je lui ai dit qu’avant de peindre un tableau, il n'y a que la toile, le cadre, la plume et l'eau, le peintre compose une peinture. “Vous aussi, vous pouvez devenir un artiste”. Elle a continué à répéter : “ça rien”. Puis, elle a ramassé une guimauve, l'a léchée avec sa langue, puis l'a tenue avec sa main. Elle a encore dit, “ça rien”.
Nous avions un jeu d'échecs sur notre table et j'ai pensé que cela serait trop difficile pour elle. J'ai donc trouvé un autre jeu dans le tiroir : assembler différents blocs à partir d’images. Au début, elle a continué à ne pas communiquer avec moi. J'ai donc commencé à mettre en place les blocs moi-même pour qu'elle puisse les voir. Quand je suis arrivée au troisième, j'ai dit : "Tu peux mettre le dernier bloc rouge ?". Elle a mis le bloc rouge. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'avoir été guérie, comme si une sorte de pont se formait progressivement entre nous. Après avoir joué le jeu, j'ai tendu la main et elle m'a donné un high five. J'ai vu son sourire. Elle m'a aussi dit son nom. Puis tout le monde s'est mis à danser et nous l’avons fait venir pour chanter et danser avec nous.
Elle a dit que lorsqu'elle était jeune, elle écrivait beaucoup et était très sensible, mais que récemment elle avait arrêté parce qu'elle n'avait pas envie d'écrire, et parce que sa santé n'était plus bonne. Elle a pris le dossier et nous a montré deux petits articles écrits sur les fourmis, à dix ans d'intervalle. Je n’ai pas vraiment compris quand je l'ai lu moi-même, car je n'arrivais pas à déchiffrer les mots qu’elle avait écrits à la main, mais ce n'est qu'après que Matteo soit venu et qu'il ait lu les deux articles avec beaucoup d'émotion que j'ai compris ce qu’elle avait écrit. J'ai été très impressionnée par l'année 1996, car c'est l'année de ma naissance. Le texte décrivait calmement quelques scènes et détails de ce que la vielle femme a ressenti lorsqu'elle a vu des fourmis dans son appartement, comment elles rampaient, des souvenirs de Paris et certaines de ses expériences. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le temps était revenu à un jour de 1996, à l'appartement à Paris, à l'air ensoleillé, humide ou sec, à l'odeur de la pièce, et aux fourmis qui rampaient sur le sol.
On essaie de se présenter et de lui demander son nom, d’entamer quelque chose, elle finit par crier “je suis sourde !” avec un air très rude. On s’excuse alors et on tâtonne pour communiquer. Matteo finit par mener la conversation par le biais de l’écriture, des sortes de flash-cards écrits bien gros, car en plus d’être sourde, Marie perd la vue. Marie n’est pas beaucoup dans le partage, elle répond à quelques questions mais semble avoir une ouïe et une vue séléctives. Une des premières choses qu’elle dira, c’est qu’elle veut le bonnet de Hong, je la sens espiègle avec cette demande. Est-ce un test ? On ne se démonte pas, si elle veut un bonnet, je lui en fabriquerai un. Alors commence ce va-et-vient semi-comique semi-tragique à cette table, je tricote tant bien que mal tout en prenant soin de réagir aux conversations que lance Mattéo. Marie finit même par chanter ! Je prends peur au milieu de l’action car je me demande si je vais vraiment arriver à délivrer ce que j’ai promis, mais en persévérant j’obtiens finalement quelque chose de mettable, un beret presque joli et trés doux que j’offre à Marie. Elle paraissait perplexe quand à la laine depuis le début de notre rencontre mais elle finit par l’accepter une fois le produit fini, c’est une victoire pour moi.
Elle m’a parlé de ses parents décédés, de sa profonde solitude, ses yeux se sont remplis de larmes, elle s’est levée et est partie. Cet après-midi m’a alors paru dérisoire et futile. Une demi-journée de visite pour nous alors que leurs journées s'enchaînent sans sortir de ces murs. Je me suis trouvée naïve de penser que venir passer un après-midi ferait forcément plaisir. Mais quand nous nous sommes mis autour du piano, que j’ai dansé pour les résidents puis que nous les avons invités à danser avec nous, j’ai vu que cet après-midi constituait bien une parenthèse, au sens de bulle dans le quotidien (aussi bien pour nous que pour eux). Ce moment m’est apparu comme nécessaire : il faut créer des moments qui rompent avec le quotidien. Anne-Marie est revenue chanter et j’ai vu dans ses yeux que les moments comme celui-ci étaient précieux pour elle aussi. J’ai l’impression d’avoir passé un après-midi au milieu d’énergies et d’émotions à la fois intenses et contraires. Des larmes et des sourires et tant de mots chaleureux en partant qui m’ont donné envie d’encore plus partager des moments, des rires, de la danse, s’ils peuvent extirper du quotidien quelques minutes et rester dans les pensées. C’était une journée compliquée et fatigante émotionnellement mais je suis ravie d’avoir pu y participer. Cet atelier m’a extrêmement touchée (6)».
Atelier 7 : « Automation & émotion : co-créer avec des réseaux de neurones profonds » avec Alice Cohen-Hadria
Alice Cohen-Hadria est maîtresse de conférence à la Faculté des Sciences Sorbonne Université et chercheuse à l’Institut de recherche et coordination accoustique/musique (IRCAM) au sein de l’équipe Analyse & Synthèse. J’ai fait une résidence en recherche artistique dans cette équipe récemment et il m’a semblé intéressant d’inviter une chercheuse venant du monde scientifique comme Alice pour nous expliquer :
- - le fonctionnement d’un réseau de neurones artificiel simple
- - les différents types de réseaux de neurones qui existent
- - la fonction des données et comment entraîner un réseau de neurones
- - les problèmes éthiques que ces entrainements posent
- - des applications artistiques avec ces réseaux
Nous avons ensuite laissé les personnes expérimenter par petits groupes le générateur de texte « ChatGPT3 » (OpenAI), le générateur d’image à partir de descriptions textuelles « DALL-E » (OpenAI), le générateur de texte à partir d’images « Img2prompt » (Replicate).
Des débuts d’histoires étranges ont émergé de la rencontre entre l’imagination des personnes et celle produite artificiellement par l’IA. Les textes et les images étaient parfois très déroutants, comme avec les portraits générés par DALL-E à partir du prénom et du nom des personnes. Un essai à propos de la politique des nénuphars a vu le jour, ainsi que des constructions monumentales de nénuphars en béton brut. La description de photos de gestes performés par les personnes a fait ressortir le nom de la performeuse Marina Abramović, et les histoires d’une banane et de la première reine sur la lune se sont croisées. Il y avait quelque chose de vivant et de vertigineux dans ces expérimentations, révélant le caractère performatif de l’artificiel mais aussi la réciprocité entre la machine et nous-mêmes. Les images et les textes qui ressortaient étaient comme des réponses boursouflées et bizarres à nos imaginaires, influençant à leur tour notre pensée. Cet atelier a montré qu’il était possible d’imaginer et d’inventer des mondes alternatifs avec la machine, que le va-et-vient entre nos images mentales et celles produites par l’IA avait le pouvoir de déstabiliser nos façons habituelles de voir et de penser. À l’issue de l’atelier je me suis demandée ce qu’un monde marshmallow pourrait devenir dans l’espace latent de l’intelligence artificielle. Un peu comme ce que nous avions vécu jusqu’à présent en nous confrontant à l’inconnu lors de ces ateliers, la co-création avec l’IA nous emmenait toujours ailleurs. C’était parfois drôle ou nul, parfois plaisant ou inquiétant.
Atelier 8 : des gâteaux et des conversations en guise de conclusion
Nous avons décidé ensemble de la forme que cette séance allait prendre : une petite fête pour se dire au revoir en offrant un geste performatif au reste du groupe. Cela pouvait être une mini performance, un texte, un gâteau, une histoire, un son, un poème… Chaque personne s’est prêtée au jeu et c’était comme si nous nous (re)rencontrions pour la première fois. Au milieu des paniers, des gâteaux, des livres, des souvenirs et des quelques traces d’ateliers que nous avions gardées, nous avons partagé ces gestes de façon improvisée.
Puis nous avons parlé des ateliers. Cette séance, comme la première, était importante car elle permettait de faire la synthèse de ce qui était arrivé, et de mettre en avant ce qui avait marché et/ou échoué pendant les ateliers.
Une personne a dit qu’elle avait été déstabilisée, ne faisant pas toujours le lien entre les éléments apportés pendant les ateliers. Une autre qu’elle était venue au cours car elle ne savait pas ce qu’était la performance, et qu’elle en repartait ne le sachant toujours pas.
Dans mon désir de responsabiliser les personnes et de former une communauté où chacun·e contribuerait à l’élaboration d’un savoir commun, j’ai réalisé que l’autonomie que je leur avais laissée n’avait pas fonctionné pour tout le monde. Le drive constituait un espace où déposer et puiser des ressources, afin que du sens puisse se faire. Dans ce drive, il y avait notamment un document collectif où chaque personne pouvait décrive une œuvre qu’elle avait piochée au début du semestre. Ces œuvres contemporaines (performances et/ou dispositifs) font partie d’un corpus que je constitue depuis quelques années. À travers cet exercice, il était question de faire découvrir des créations récentes qui ne figurent pas encore dans des livres sur la performance. En proposant aux personnes d’aller chercher sur internet des informations sur ces œuvres et de les rassembler sous la forme d’un petit texte, l’idée était qu’elles découvrent et fassent découvrir au reste du groupe le geste d’un·e artiste peu connu·e.
J’ai aussi proposé aux praticien·ne·s invité·e·s de déposer dans ce drive des textes et des références liées à leurs pratiques, pour que nous puissions mieux les situer. Il y avait également le dossier Ressentis et notes entre les ateliers dans lequel les personnes pouvaient écrire au groupe et lire ce que les autres avaient exprimé. Et enfin, il y avait une archive de chaque atelier (photos, vidéos, sons), permettant d’adopter encore un autre point de vue sur les séances. Tout cela constituait une matière que les personnes pouvaient investir. Le savoir n’était ainsi pas donné mais fragmenté, via ces bribes s’accumulant dans le drive. Parce que le programme des séances était chargé, la contribution à cette plateforme et l’articulation entre ces éléments ne se faisaient que de façon individuelle et en dehors des ateliers. Il aurait été préférable de nous en emparer ensemble lors d’un atelier.
D’autres personnes ont dit avoir apprécié passer d’une activité à l’autre et ont mis en avant le faire comme quelque chose qui se cherche et n’est pas toujours intelligible. Une personne a évoqué le Maître-ignorant (1987) de Jacques Rancière, et nous a raconté l’aventure intellectuelle vécue par Joseph Jacotot dans le chapitre premier du livre. Professeur à Louvain en 1818, Jacotot s’est retrouvé face à des étudiants hollandais avec qui il ne pouvait pas communiquer. Il leur proposa alors de se baser sur une édition bilingue de Télémaque pour apprendre le français. En s’appuyant sur cette histoire où les élèves avaient appris par eux-mêmes une nouvelle langue, la personne a dit avoir aimé ne pas recevoir de « cours sur » la performance. Elle s’est sentie d’égale à égale avec moi, disant que je participais aux ateliers, que je les vivais, et que j’en subissais aussi les défauts. Elle a alors émis l’hypothèse qu’avec plus de temps et d’expérience, il aurait même peut-être été possible pour le groupe de mener le cours à ma place.
Une autre personne a relié la singularité de l’atelier à la pratique même de la performance. Selon elle, la performance est quelque chose qui agit en faisant, et que dans certaines situations, la performance échoue. La pratique de la performance nous pousserait à adopter un rapport plus humble à la réalité, car elle nous demanderait de constamment nous y adapter. À l’image de nos ateliers, c’est en réitérant l’expérience, en vivant de multiples situations dans différents contextes, que la capacité d’écouter ce qui est en train de se passer et d’y répondre avec justesse se trouve.
Puis la question de la contrainte a été soulevée. Les ateliers ne parlaient pas à tout le monde mais les mises en situations demandaient aux personnes de produire des gestes et de se laisser surprendre. Certaines personnes ont dit être émues et fières des objets fabriqués pendant les ateliers, sans très bien savoir quel était leur statut. D’autres ont affirmé avoir été entraînées dans des univers totalement inconnus, et avoir découvert par la pratique des capacités insoupçonnées. Un sentiment de risque semblait avoir été vécu lors de nos séances, et une personne a parlé du drive pour dire que le dossier Ressentis et notes entre les ateliers était lui aussi une prise de risque : en plus de donner la possibilité de dévoiler ses sensations et ses pensées aux autres, il ouvrait la possibilité d’une critique. Il n’était en effet pas forcément facile de lire ce que les personnes écrivaient, car ça n’était pas toujours positif. Les personnes y ont formulé leurs doutes et leurs questionnements, et elles y ont critiqué certaines choses qui avaient été dites ou faites. Bien qu’elles s’en soient servi avec une grande bienveillance, c’était à la fois riche et éprouvant à lire. Cet espace nous a permis de rester en lien et de converser autour de ce que nous faisions, et j’ai perçu dans cette expérience ce que Bell Hooks entend par « risque » dans son livre Apprendre à transgresser, l’éducation comme pratique de la liberté. Elle y écrit « plutôt que de se concentrer sur des soucis de sécurité, je pense qu’un sentiment d’appartenance crée un sentiment d’engagement partagé et de bien commun qui nous lie (7)». Cet espace collectif a permis aux personnes d’échanger sur ce qu’elles ressentaient de façon directe et sincère. Dans l’un de ces textes, une personne a écrit que ce qui comptait pour elle n’était pas tant la réussite de l’atelier ou du dispositif que son éventuelle critique : «la possibilité de la critique est une réussite qui surpasse l'échec du dispositif parce que peu importe le dispositif, il est critiquable. Critiqué, il devient autre chose. Il devient collectif. Il cesse d'être vertical, il s'horizontalise. Mis au niveau des participant.es, le dispositif devient malléable (8)».
L’élaboration d’un savoir commun à partir d’une démarche sensible qui impliquait la découverte et le risque nous a aussi permis de travailler à partir de nos vulnérabilités. Ne sachant pas ce que nous allions vivre avec les praticien·ne·s invité·e·s ou lors de la rencontre à l’Ehpad, il a fallu braver certaines peurs, certaines gênes, esquisser de nouveaux gestes et accepter de possibles échecs et maladresses. Pour que cela puisse se faire, nous avons dû nous serrer les coudes et agir en communauté.
J’aimerais conclure en invoquant le concept d’étude chez Stefano Harney et Fred Moten. Pour les auteurs l’étude ne commence et ne termine pas au début et à la fin d’un cours, elle est là, elle est déjà présente, elle est dans les interstices : «je crois que l’enjeu de l’étude est que la vie intellectuelle est déjà au travail autour de nous. Quand je pense à l’étude, je peux tout autant penser aux infirmier*es dans le coin fumeur*ses qu’à l’université (9)». Boire du thé, marcher à travers le campus, préparer la salle ou manger un gâteau ensemble, n’étaient pas moins importants que ce que nous avons expérimenté au sein des ateliers. C’est cet ensemble de gestes auxquels chacun·e a contribué à sa manière qui constitue le « savoir » du cours. Et ce savoir est encore en train de se faire, dans les pratiques et dans les conversations des personnes, bien au-delà de ce que nous avons vécu ensemble.
(1) L’arpentage est une pratique de lecture collective provenant des cercles ouvriers du XIXe siècle dont le maintien dans l’ignorance constituait un enjeu de pouvoir de la classe dominante. Cette méthode réutilisée dans d’autres contextes aujourd’hui consiste à découvrir à plusieurs un ouvrage : chaque personne lit un passage différent pour en discuter ensuite collectivement.
(2) Note déposée le 05.10.22 dans le dossier « Ressentis et notes entre les ateliers » du drive collectif.
(3) Note déposée le 13.10.22 dans le dossier « Ressentis et notes entre les ateliers » du drive collectif.
(4) Assia Chabane, note déposée le 18.10.22 dans le dossier « Ressentis et notes entre les ateliers » du drive collectif.
(5) Note déposée le 04.11.22 dans le dossier « Ressentis et notes entre les ateliers » du drive collectif.
(6) Ce récit rassemble des extraits de textes de Coline Cerf, Han DU, Hong QU, Younès Guilmot, Lena Karson, Minghao WEN, Assia Chabane, Pauline Robert.
(7) Bell Hooks, « Embrasser le changement : enseigner dans un monde multiculturel », Apprendre à transgresser, l’éducation comme pratique de la liberté, Paris : Éditions Syllepse, 2019 [1994], p. 69.
(8) Woiz, Et comment faire maintenant pour transformer cet échec en autre chose, texte déposé le 06.11.22 dans le dossier « Ressentis et notes entre les ateliers » du drive collectif.
(9) Stefano Harney et Fred Moten, «L’antagonisme général, conversation avec Stevphen Shukaitis », Les sous-communs, Montreuil : Éditions Brook, 2022, p. 79.