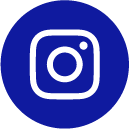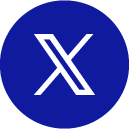Date
12/02/2025
Lieu
université Paris Nanterre
Bâtiment de la formation continue - salle R06
Infos pratiques
13h30
Matérialité, accessibilité, frictions : une analyse des dispositifs socio-techniques autour de l’autisme et de la neurodiversité
Lucas Fritz est doctorant en sciences de la communication et en sociologie, rattaché aux laboratoires du DICEN-Idf (Université Paris Nanterre) et de l’IRIS (EHESS). Il enseigne à l’Université Gustave Eiffel et écrit pour diverses revues (Multitudes, Polymorphes, Regards, Trou Noir, etc.). Ses travaux de recherche portent actuellement sur la place des dispositifs de communication dans l’émergence des mouvements sociaux de la neurodiversité, et sur le rôle du validisme et des normes d’accessibilité de ces dispositifs dans les pratiques d’enquête de terrain en sciences sociales.
La thèse est co-dirigée par Marta Severo et Joëlle Vailly.
—
Les mouvements sociaux de la neurodiversité, surtout portés par des personnes autistes, revendiquent une manière différente de communiquer et une épistémologie parfois controversée.
Ces revendications se manifestent néanmoins via des dispositifs de communication ordinaires (blogs, livres, manifestations) et soulèvent les problématiques suivantes : quels rôles les dispositifs de communication, leur matérialité et leur accessibilité, jouent-ils dans les controverses autour de l’autisme et de la neurodiversité ? Quelle est la place de ces dispositifs et de leur accessibilité dans les pratiques d’enquête en sciences sociales ?
Pour répondre à ces problématiques, la thèse éclaire les données issues de plusieurs enquêtes (n)ethnographiques à la lumière d’un cadre théorique mixte, combinant approches en sciences de l’information et de la communication, en sociologie, et approches dites crip.
Elle montre notamment que les dispositifs numériques contribuent à normaliser les discours sur l’autisme, et incitent les individus à masquer leur handicap et les frictions d’accès. Elle montre comment ces dispositifs normalisent les interactions en face-à-face, à travers une surveillance participative, et un ajustement attentionnel et corporel. Dans ce dernier cas, elle articule accessibilité et entraînement à la table, ouvrant sur la place des tables institutionnelles dans les pratiques en sciences sociales.
Elle se termine par une réflexion épistémologique sur l’accessibilité des dispositifs de communication mobilisés à chaque étape de l’enquête de terrain, et insiste sur la co-constitution des pratiques en sciences sociales et des controverses autour de l’autisme et de la neurodiversité.