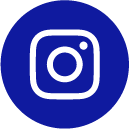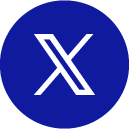Programme du Diplôme inter-universitaire ArTeC+ année 2024-2025
« Contre-enquêtes »

Image d’illustration tirée d’une œuvre de Raffard-Roussel
Dans notre monde hautement numérisé, nous avons accès à une quantité inépuisable d’informations et pourtant, la réalité semble de plus en plus difficile à appréhender. Faut-il pour autant renoncer à comprendre en profondeur la nature des différentes crises environnementales, politiques et sociales auxquelles nous sommes confronté·es ?
Toute une génération d’artistes, d’écrivain·es et de chercheur·ses se réunit autour de l’idée qu’il est, face à ces enjeux, nécessaire de renouveler les formes d’investigation. Luttant à la fois contre le complotisme qui simplifie la réalité, et le dogmatisme qui impose une seule vision du monde, ces enquêteur·es nous invitent à prendre en charge par nous-mêmes la construction des épistémologies auxquelles nous souhaitons adhérer. Face aux enjeux de pouvoir qui trament les régimes de vérité dominants, avec leurs « certitudes inébranlables » et « vérités incontestables », ils et elles mènent des contre-enquêtes pour montrer que les faits résultent, avant tout, d’une quête du sens.
La recherche d’une forme, d’un discours, d’un récit de restitution passe par la formulation d’hypothèses, par des découvertes mais aussi des errements, des révélations précaires ; elle s’appuie sur des processus de sélection, de découpe, de focalisation – sur une fabrique. Anna Tsing et Donna Haraway exposent cette fabrique pour, par exemple, mieux comprendre la crise écologique. Pacôme Thiellement et Pierre Bayard, à travers leurs contre-enquêtes, sondent le double fond de grandes figures de la pop culture. Nicolas Nova et Natasha Dow Schüll proposent d’enquêter autour d’objets technologiques afin de nous éclairer sur notre rapport au numérique. On pense aussi aux travaux du collectif Forensic Architecture et de Trevor Paglen dans le domaine des arts visuels, aux livres de Franck Leibovici, Neige Sinno, François Bon ou Kamel Daoud dans le champ de la littérature, à Ivan Jablonka et Emmanuel Carrère, ou bien encore aux films de Chloé Galibert-Laîné dans le champ du documentaire.
Pour beaucoup il ne s’agit pas d’exposer des résultats, mais de faire le récit de l’enquête. Ces récits se font également en pleine conscience de la violence que peut représenter l’appropriation et la restitution d’une voix par l’artiste. Si les auteur·es n’hésitent pas à adopter la première personne, ce n’est pas pour imposer un Je prédateur, empli de certitudes, mais au contraire, pour assumer pleinement le fait que la présence de l’observateur·e transforme le phénomène observé. Il s’agit de faire émerger une « esthétique d’investigation » qui intègre, sans les homogénéiser, des points de vue multiples sur le monde. Les contre-enquêtes contemporaines aboutissent non pas lorsqu’elles établissent des certitudes, mais lorsqu’elles butent sur les contradictions relevées sur le terrain de l’investigation, qui fragilisent les tentatives de faire récit et amènent l’artiste-chercheur·e à explorer d’autres formes.
Pour l’année 2024-2025, le DIU ArTeC+ propose d’explorer et d’expérimenter les formes, figures et formats de la contre-enquête contemporaine en faisant dialoguer arts et sciences sociales. À travers un programme de rencontres, d’ateliers pratiques et d’expérimentations méthodologiques, cette formation propose un parcours qui s’adresse autant aux artistes, aux écrivain·es et aux musicien·nes ; qu’aux curateurices, aux sociologues et aux philosophes. Le but de cette formation est de permettre à chacun·e d’élaborer la manière avec laquelle elle ou il désire « faire connaissance » avec ses objets de recherches, dans une perspective de recherche-création.