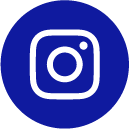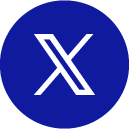À partir d’une exploration des collections non-film de la Cinémathèque française, cet atelier laboratoire propose une relecture de l’histoire du cinéma en France au prisme du féminisme
Le module est proposé par : Mention Cinéma et audiovisuel, université Paris 8
Parcours : Théorie, histoire, esthétique
Lieu(x) : Cinémathèque française
Contact : Hélène Fleckinger - helene.fleckinger@gmail.com
Présentation
Conçu dans une perspective interdisciplinaire liant savoirs et pratiques, au croisement d’enjeux méthodologiques, historiographiques et épistémologiques, cet atelier-laboratoire propose de contribuer à une relecture de l’histoire du cinéma au prisme du féminisme, à partir des archives conservées à la Cinémathèque française. Il entend offrir aussi aux étudiant·es l’occasion d’expérimenter les technologies numériques au service de nouveaux modes d’analyse, d’écriture et de publication scientifique, entre recherche et création. Cet atelier-laboratoire explorera ainsi les collections non-film de la Cinémathèque française (partenaire principal du MIP), en particulier les fonds d’archives écrites et iconographiques conservés à la Bibliothèque (Espace chercheurs et Iconothèque), qu’il s’agira d’étudier et de valoriser scientifiquement. Il aura pour objectif la réalisation collective d’une plateforme éditoriale, numérique et collaborative, destinée à faire connaître des ressources disponibles pour une reprise de l’histoire du cinéma en France sous l’angle du féminisme, à les analyser et à partager les travaux des étudiant·es.
L’atelier-laboratoire articulera plusieurs axes de travail :
- Une partie théorique centrée sur l’appropriation des problématiques et du corpus : écriture de l’histoire du cinéma en France et relecture au prisme du féminisme ; histoire du patrimoine cinématographique, en particulier de la Cinémathèque française ; enjeux méthodologiques, heuristiques et créatifs autour des publications numériques et des narrations transmédiatiques
- Une séquence de travail intensif autour du logiciel libre Omeka-S, orientée vers la prise en main et l’expérimentation de ce logiciel de gestion de bibliothèque numérique utilisé pour réaliser la plateforme éditoriale visée
- Une exploration approfondie d’une sélection de documents écrits et iconographiques issus des collections de la Cinéma-thèque française, encadrée et menée en groupe restreint.
Compétences à atteindre
Les étudiant·es seront ainsi formé·es, sur un plan à la fois théorique et pratique, à des problématiques croisant histoire du cinéma, féminisme et humanités numériques ainsi qu’à la création d’une plateforme éditoriale numérique et collaborative, conçue à partir du logiciel libre de gestion de bibliothèque numérique Omeka-S.
Calendrier
6 journées de travail en groupe complet
Vendredi 6/02
Vendredi 20/02
Vendredi 13/03
Vendredi 27/03
Vendredi 10/04
Vendredi 17/04
Journée de restitution des travaux le jeudi 07/05
Matin : séances de séminaire collectif
Après-midi : recherches menées en autonomie partielle dans les archives et travaux de groupe encadrés
Ce MIP est incompatible avec un autre enseignement qui se déroulerait aussi le vendredi
Valorisation du module
Ce MIP est orienté vers la réalisation collective d’une plateforme éditoriale numérique et collaborative, entre guide des sources et carnet de recherche, restituant les travaux des étudiant·es. Ceux-ci seront par ailleurs présentés publiquement lors d’une journée de restitution qui se tiendra à la Cinémathèque française à la fin du semestre et qui sera ouverte à d’autres institutions patrimoniales et chercheur·euses en Histoire du cinéma, Genre et Humanités numériques.
Profil attendu des étudiant·es
Les étudiant·es doivent posséder une bonne culture en histoire du cinéma, en particulier en France, témoigner d’une appétence pour les enjeux historiographiques et numériques et apprécier une organisation du travail alliant dynamique collective et autonomie. Des compétences complémentaires en archives et patrimoine, études de genre, gestion de bases de données, création numérique et graphisme (dessin) sont très bienvenues.