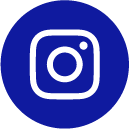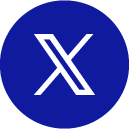Le vocabulaire « créationniste » mérite de susciter notre suspicion, en dehors même des idéologies religieuses qu’il charrie chez les chrétiens mobilisés par des croisades anti-darwinistes. La référence à l’activité créative chez les humains demande en effet à être dégagée d’une triple gangue qui l’expose aux appropriations les plus douteuses. La première est la gangue romantique, nourrie elle-même de créationnisme religieux, qui projette sur le génie une faculté quasiment transcendante de faire advenir à l’être quelque chose issu de rien, sinon d’une puissance purement interne à l’individualité créatrice. La deuxième est la gangue « Bohème », qui assimile le créateur à l’individu d’exception, au sein de milieux déterritorialisés alimentés par la seule force de volonté des imaginations qui les habitent. La troisième est la gangue « néolibérale », qui traduit la création en termes d’« innovation », c’est-à-dire qui la juge selon sa seule capacité à générer des produits marchands pouvant faire l’objet de captation de profits, à travers la mainmise sur des droits de propriété et la commercialisation de masse.
Que reste-t-il de la référence à la « création » si on la vide de ces différents types de contenus ? Si elle n’est plus qu’une coquille vide, que peut-on essayer d’y réintroduire pour lui insuffler une crédibilité renouvelée ? Plus précisément, puisque mon propos ne visera pas tant « la création » en général que ce que l’espace institutionnel des universités peut faire pour favoriser en son sein les dimensions créatives de nos comportements : quels grands principes peut-on aujourd’hui convoquer pour essayer de faire de nos universités des « maisons de la création » autant que des temples du savoir ?
J’essaierai de répondre à ces questions en proposant d’abord trois décalages conceptuels susceptibles de recadrer la notion de création en la débarrassant des ambiguïtés dénoncées à l’instant, puis en suggérant sept reconfigurations institutionnelles qui pourraient aider nos universités à favoriser les activités créatrices de sens et de valeur, enfin en esquissant trois droits humains qu’il me semble utile de placer à l’horizon de nos réflexions sur la création.
Le travail d’amplification
J’irai d’abord puiser chez Gilbert Simondon une réflexion sur l’amplification, qui récuse l’imaginaire de la création a nihilo pour lui substituer l’idée d’une augmentation sélective de quelque chose de préexistant. On ne se situe plus ici dans l’agentivité individuelle du génie créateur mais dans des processus collectifs de déplacement, de contamination, d’évolution, d’infléchissement et de traduction. Cela conduit Simondon à distinguer trois modes d’amplification.
1- Au niveau le plus élémentaire, il y a amplification transductive lorsqu’une transformation se propage de proche en proche, à l’intérieur d’un domaine ou à travers des domaines apparemment séparés. L’exemple emblématique de la transduction est le phénomène de cristallisation qui se produit lorsqu’on introduit un germe cristallin microscopique dans une solution sursaturée : « chaque couche du cristal déjà constitué sert de signal pour la solution sursaturée immédiatement voisine, et l’amène à se cristalliser ».
2- Il y a amplification modulatrice lorsque la propagation de la transformation est gouvernée (restreinte, limitée, partiellement inhibée) par un mécanisme de contrôle : alors que la transduction se propage à travers des réactions en chaîne de nature spontanée, la modulation soumet l’amplification à un appareil qui contrôle certains inputs afin de maintenir les outputs au sein de certaines marges de variation.
3- À un troisième niveau, enfin, il y a amplification organisante lorsqu’une transformation bute sur une incompatibilité entre les données que rencontre sa propagation. L’exemple emblématique en est fourni par « la manière dont est reçue et intégrée l’information visuelle en régime de perception binoculaire » (GS : 170). Il y a « disparation » (hétérogénéité, incompatibilité, non-superposabilité) entre ce que perçoit chacun des deux yeux, mais « la tension d’incompatibilité entre les deux images rétiniennes devient sériation, organisation compatibilisante et totalisante, principe dimensionnel d’ordre plus élevé » (GS : 170), dès lors que ces deux images s’intègrent dans un système à trois dimensions (et non plus dans un champ plane).
On voit en quoi ces différents types d’amplification peuvent nous aider à comprendre la dimension créative de ce que font les universités. Celles-ci peuvent être conçues comme des lieux d’amplifications transductives (par effets d’interdisciplinarité), modulatrices (à travers les orientations proposées à la recherche), mais aussi et surtout organisantes, puisque c’est lorsqu’on bute sur des incompatibilités et des disparations que la recherche devient excitante et réellement inventrice (conduisant à ce que Thomas Kühn nous a appris à reconnaître comme un changement de paradigme).
Cela implique toutefois de réviser nos conceptions les plus fondamentales de l’espace universitaire, qui doit moins apparaître comme le terrain neutre et aseptisé orienté vers la production de vérités à vocation universaliste (ce qu’il est aussi, bien entendu), que comme un lieu instable fait pour accueillir le disparate et faire réagir l’hétérogène, à commencer par ce qui est hétérogène au ronronnement administratif de l’université et des « sciences ». Si elles veulent mobiliser la force créative propre à l’amplification simondonienne, les universités doivent se concevoir comme des lieux d’élaboration des conflits (interprétatifs), des « disparations » qu’elles doivent apprendre à cultiver pour en tirer l’émergence de dimensions supérieures et inédites.
L’actualisation des virtuels
On peut trouver dans la pensée d’Étienne Souriau ‒ récemment remise au goût du jour par une belle réédition augmentée d’un texte co-signé par Isabelle Stengers et Bruno Latour ‒ un deuxième recadrage qui substitue à la notion de création ex nihilo une sensibilité aux processus d’actualisation de virtuels déjà existants, que notre intervention ponctuelle aide à faire passer à d’autres « modes d’existence ».
Dans une veine inspirée de Bergson, Souriau aide à préciser ce qui fait l’originalité de la notion de « virtuel », si fréquemment sollicitée aujourd’hui mais si rarement exploitée dans sa profondeur :
Dire qu’une chose existe virtuellement, est-ce à dire qu’elle n’existe pas ? Nullement. […] C’est dire qu’une réalité quelconque la conditionne, sans la comprendre ou la poser. […] L’arche du pont cassé, ou commencé, dessine virtuellement la retombée qui lui manque. La courbe des ogives interrompue, en haut des colonnes, dessine dans le néant la clé de voûte absente. […] Le pont que personne ne songe à construire, dont on ignore même la possibilité, mais dont tous les matériaux sont là, et dont la nature, la portée, la forme, sont parfaitement déterminés à titre de seule solution d’un problème dont toutes les données sont parfaites et ignorées, existe d’une existence virtuelle plus positive que celui qu’on a entrepris et dont un vice ou une insuffisance de conception rend l’achèvement impossible.
En nous décrivant comme vivants « au milieu d’une forêt de virtuels inconnus, dont quelques-uns peut-être admirables » (ES : 138), Souriau nous invite à reconnaître la convergence entre ce que nos disciplines actuelles mutilent en les faisant ressortir de deux types d’activité radicalement différentes (les sciences vs. les arts ; l’observation vs. la création). La vie restituée dans la forêt des virtuels qui l’environnent découvre que ce qu’il y a à créer est déjà là (virtuellement) : il ne faut pas tant l’imaginer (en fermant les yeux, selon un modèle romantique) que le repérer (par une observation scientifique du donné) dans nos conditions d’existence. L’actualisation des virtuels est moins une affaire d’imagination inventrice que de compréhension de nécessités structurelles : non pas liberté artistique contre rigueur scientifique, mais capacité à épouser, représenter, simuler et infléchir les conditions et les mouvements du réel.
L’activité d’instauration
Pour désigner l’actualisation du virtuel, Souriau mobilise un terme qui peut nous servir d’alternative à celui de création, contaminé par les trois gangues évoquées en début de cet article : l’instauration. L’exemple classique en est celui de l’émergence de la statue à partir d’« un tas de glaise sur la sellette du sculpteur » :
en regardant œuvrer le statuaire, je vois comment la statue, d’abord œuvre à faire absolument distincte du bloc de marbre, à chaque coup du ciseau et du maillet peu à peu s’incarne dans le marbre. Peu à peu le marbre se métamorphose en statue. Peu à peu l’œuvre virtuelle se transforme en œuvre réelle. Chaque acte du statuaire, chaque coup du ciseau sur la pierre, constitue la démarcation mobile du graduel passage d’un mode d’existence à un autre. (ES : 201).
Le processus d’instauration est conditionné par la dynamique de trois facteurs indissociables : 1° la liberté : le peintre « est libre, sur sa palette, de choisir du bleu ou du rouge, et c’est dans cette liberté entière de choix que commence, d’une manière ou d’une autre, quelle que soit l’œuvre à instaurer, l’action de cet agent instaurateur » (ES, 203) ; 2° l’efficacité de la part de celui qui « opère la création » : les virtuels ne peuvent s’actualiser et prendre effet que si l’instaurateur respecte leur nécessité et leur consistance propre (sanctionnées par le fait que la statue ou le pont tiendront debout ou non) ; 3° l’errabilité de toute pratique instauratrice : « après avoir apporté sa liberté et son efficacité, l’agent apporte aussi son errabilité, sa faillibilité, sa soumission à l’épreuve du bien joué ou du mal joué. Il peut placer librement où il le veut son coup de pinceau. Mais s’il le place mal, tout est manqué, tout s’écroule » (ES : 204).
Une première conséquence très pratique peut être tirée de ces remarques pour la conception du travail universitaire : la recherche artistique et la recherche scientifique reposent sur des montagnes d’« échecs », du point de vue de la performance, qui n’en sont pas du point de vue de la compétence acquise. L’errabilité est l’autre face indissociable de l’efficacité : le culte de la réussite, du succès, de la performance, qui pèse de plus en plus lourdement sur les pratiques de recherche, sape leurs conditions même de possibilité.
Cette première conséquence a un corollaire immédiat : la dynamique d’instauration requiert un certain rapport au temps caractérisé par le fait 1° d’être non-linéaire (les heures de travail ne sont pas directement proportionnelles aux résultats produits) et 2° d’exiger une suspension des demandes de résultats immédiats, demandes qui ont de plus en plus tendance à étouffer les activités de recherche (la « productivité » d’une idée, d’une découverte ou d’une œuvre se diffuse en tant d’externalités possibles qu’il est impossible et mutilant de prétendre la réduire à ce qu’on parvient à en mesurer).
Une deuxième conséquence nous invite à tempérer les rigidités disciplinaires et méthodologiques en les ouvrant aux audaces d’un empirisme davantage pragmatique. Certes l’université et le savoir scientifique se spécifient par leur effort pour expliciter chaque pas de leur démarche, alors que les pratiques artistiques se contentent de produire quelque chose qui tienne debout sans avoir à rendre compte des raisons et des mesures précises expliquant que cela tienne. Mais à la fois la pratique concrète des sciences, telle que l’ont éclairée Bruno Latour ou Paul Feyerabend, et la part d’intuition qui anime toute activité inventrice exigent de reconnaître tout ce qui, dans l’instauration, dépasse et excède la simple application de protocoles prédéfinis. De par sa nature propre, l’activité d’instauration récuse a priori toute distinction hermétique entre pratiques artistiques et pratiques scientifiques.
Sept implications institutionnelles
Si l’on accepte de recadrer les pratiques relevant de « la création » en termes d’amplification, d’actualisation de virtuels et d’instauration, alors on se trouve conduit à devoir imaginer de profondes réformes institutionnelles dans la façon dont nous administrons le travail de recherche au sein de nos universités. J’esquisserai rapidement sept voies générales de réflexion, qu’il reste à traduire en autant de préconisations concrètes.
1. Faire de l’ensemble des universités des « maisons de l’instauration ». La tendance actuelle tend d’ores et déjà, sur un point au moins, à faire converger les recherches scientifiques développées dans les universités et les pratiques créatives réalisées dans les écoles d’art, mais cela ne paraît se faire que sur le mode du plaquage mécanique plutôt que du métissage inventif. Au lieu d’une harmonisation à sens unique qui demande aux écoles d’art d’importer les formats de diplomation en vigueur dans les universités (mémoire de master, thèse de doctorat), il serait bon de saisir cette occasion pour réformer les cursus universitaires en leur insufflant un peu de la transversalité permise par les écoles d’arts ‒ dans le sillage de ce que propose par exemple l’Ecole des Arts Politiques initiée par Bruno Latour à Sciences Po Paris ou du master CCC (Critical Curatorial Cybermedia) dirigé par Catherine Quéloz à la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève (HEAD). Loin de devoir leur imposer leurs rigidités sclérosées, les universités ont tout à apprendre de la vivacité de ce type de programmes, qui apprennent à construire des capacités de recherche en alliant les vertus complémentaires des enquêtes en sciences sociales et des expérimentations artistiques.
2. Décloisonner les parcours des étudiants. Les Humanités sont en crise, nous dit-on : de moins en moins d’étudiants s’inscrivent en littérature, en philosophie, ou en histoire de l’art. Face à cette atrophie de leur audience, les disciplines sont tentées d’affirmer leur singularité en se repliant sur elles-mêmes ‒ se coupant encore plus dramatiquement de leur public potentiel. C’est dans la direction inverse qu’elles gagneraient toutefois à s’orienter. La condition de survie des Humanités, c’est de faire que tout le monde y passe, et que tout le monde en sorte. Chacun sera un meilleur généticien, chirurgien, juriste, économiste, manager, s’il peut enrichir sa pensée et sa pratique grâce aux problématisations multidimensionnelles cultivées et renouvelées sans cesse par les les Humanités. Au lieu d’enfermer les étudiants ‒ au niveau de la licence, mais aussi du master ‒ dans des enseignements étroitement disciplinaires, il faut réformer les cursus pour amener chacun à participer aux recherches en cours dans les domaines les plus variés. Non pas multiplier les cours d’introduction qui saupoudrent une connaissance superficielle d’une discipline considérée en surplomb (il y a de très bons manuels qui suffisent à faire cela), mais initier chacun aux modalités de recherches et de problématisations propres aux grands champs de la pensée contemporaine. Il faut donc reconnaître aux étudiants le droit minimal reconnu aux poulets ‒ celui de libre parcours entre les disciplines.
3. Désindividualiser les parcours, les performances et les compétences. En même temps qu’ils montent au créneau pour récuser les nouvelles modalités d’évaluation appliquées à la recherche, les enseignants-chercheurs feraient bien de questionner et de réviser complètement les évaluations auxquelles ils soumettent les étudiants. Les pratiques obscurantistes et inquisitoriales d’une séquence d’examens personnalisés doivent être tempérées par la multiplication de travaux de recherche et de réflexion collective. Il est paradoxal (mais révélateur) que ce soient aujourd’hui les Business Schools qui favorisent davantage que les Humanités le travail collaboratif en équipe (alors même que leur idéologie promeut la compétition et l’individualisme !). Ce que nous devons aujourd’hui apprendre à « créer », c’est-à-dire à instaurer, ce sont bien moins des « œuvres » que des modes de collaborations qui bénéficient de façon transductive des hétérogénéités personnelles, linguistiques, idéologiques, culturelles qui nous distinguent en même temps qu’elles nous enrichissent. Les vrais défis de l’enseignement et de la recherche consistent à construire des compétences qui nous permettent ‒ par amplification organisante ‒ de surmonter les disparations et les incompatibilités qui paralysent nos collaborations.
4. Rééquilibrer la disproportion actuelle entre acquisition de savoirs et apprentissage de l’instauration. La progressive autonomisation de l’accès aux contenus, qui se poursuit depuis le moyen-âge, s’est dramatiquement accélérée au cours des dernières années, grâce aux merveilles de l’Internet. L’enseignement supérieur n’a pas encore intégré le bouleversement induit par Google, Wikipedia et l’ubiquité de l’everyware : alors que les enseignants se conçoivent encore majoritairement comme des déverseurs de contenus, nos étudiants sont de plus en plus dynamisés par « l’éthique hacker » qui encourage chacun à bricoler par tâtonnements spontanés, en puisant abondamment dans le savoir factuel qui est désormais au bout des doigts des plus ignorants. Ce qu’il faut apprendre dans le cadre de l’interaction didactique, ce ne sont plus tant des contenus que des capacités à gérer l’accès à ces contenus, leur utilisation, leur critique et leur enrichissement. L’apprentissage doit donc porter sur l’habileté d’instauration, composée, comme on l’a vu, à la fois de liberté d’imagination, de souci d’efficacité et de responsabilité envers l’errabilité. Au sein d’une université qui n’a plus pour fonction de transmettre des contenus mais de construire les compétences nécessaires à l’activité d’instauration, les étudiants sont à considérer ‒ dès leur entrée en licence ‒ comme étant des « chercheurs », c’est-à-dire à la fois des scientifiques et des artistes.
5. Tirer les conséquences du fait que nous enseignons bien davantage par ce que nous faisons que par ce que nous disons. Plus que par le contenu de ce que nous disons en classe, nous enseignons par les gestes relationnels opérés envers et avec nos étudiants. Les gestes transmettent bien plus de contenu par imitation transductive que par explicitation formelle. L’apprentissage des disciplines intellectuelles est autant une affaire d’imitation que l’apprentissage des habiletés manuelles : ce sont les gestes relationnels du chercheur, du collaborateur ou du directeur d’équipe qu’il faut apprendre aux étudiants ‒ autant que l’analyse du pronom relatif, de la forme-sonnet ou des matrices ISLM.
6. Considérer les processus de subjectivation à l’œuvre dans la recherche comme aussi importants que les résultats de ces recherches.Les activités de recherche sont indissociablement des constructions d’objets de connaissance et de sujets de ces connaissances. Un scientifique, un professeur, un expert sont définis non seulement par le contenu cognitif de leur cerveau, mais tout autant par certaines formes de subjectivation, qui ne sont nullement « données » : elles doivent être construites, de façon plus ou moins satisfaisante (de l’enseignant-mentor au mandarin tyrannique et à l’expert arrogant). Chaque individu doit apprendre à assumer différentes identités selon les heures de la journée : l’effort d’intégration de ces multiples identités au sein d’une subjectivité non-schizophrénique est à l’horizon de tout devenir-artiste ; il doit également être inclus dans la façon dont nous envisageons les études universitaires ‒ qui produisent non seulement des expertises mais aussi des modes de subjectivation.
7. Valoriser à la fois la constitution de protocoles nouveaux et la résistance à toute forme de protocole. Comme toute forme d’instauration artistique et scientifique, l’activité de recherche est travaillée par une contradiction centrale : elle repose sur des protocoles hérités ; elle tend à instaurer des protocoles à venir ; mais elle ne peut intervenir qu’en suspendant les protocoles actuellement en vigueur. Dans un univers de plus en plus intimement conditionné par des protocoles et de programmes informatiques (encodages, encryptions, algorithmes, logiciels de comptabilité, formulaires en lignes, profilages numériques, etc.), la part d’humanité de nos rapports sociaux est érodée par la machinisation protocolaire de nos interactions : on ne peut pas convaincre un logiciel de passer outre à une commande inappropriée. Toute « création » commence donc par buter contre une programmation qu’il est de plus en plus difficile d’esquiver. Au sein des universités, les Humanités doivent se redéfinir autour d’une fonction qui leur est désormais centrale, celle de questionner et de récuser les protocoles et les programmes préexistants (ce qui a été le trait distinctif de tout l’art moderne). Cette nouvelle fonction porte en elle trois germes de revendications que je vais rapidement passer en revue pour conclure cette réflexion trop sommaire.
Trois revendications politiques
Si elles veulent se concevoir comme des « maisons de l’instauration », les universités doivent reprendre à leur compte trois revendications qui les excèdent largement, mais qui les concernent directement. Ces trois revendications prennent le contrepied de l’idéal de transparence animant, en parallèle, 1° l’idéologie scientifique universaliste, 2° une conception obsolète de la pédagogie et 3° la pratique actuelle de la gouvernementalité algorithmique globalisée, telle que celle-ci se met en place à travers nos nouvelles puissances de programmation numérisée.
1. Revendiquer un droit à la reformulation. Nous subissons de plus en plus dramatiquement la tyrannie des protocoles ‒ qui passe par des formes diverses de gestion comptable rigide et myope, d’évaluation illusoirement objectiviste, de procédure bureaucratiques tatillonnes, de formulaires sclérosés qui bloquent toute forme d’hétérogénéité par rapport à une normalité pré-paramétrée. Contre cette tyrannie du formulaire, nous devons revendiquer un droit à la re-formulation. L’université doit se concevoir ‒ envers l’extérieur comme dans son fonctionnement interne ‒ comme un lieu de re-formulation des règles, ce qui implique de pouvoir altérer, moduler les paramétrages existants. Cela implique d’adopter une attitude de souplesse et d’autocritique envers tout paramétrage déjà instauré.
2. Revendiquer un droit à l’opacité. Avec l’écrivain martiniquais Édouard Glissant, on peut s’inquiéter des effets homogénéisateurs des impératifs d’une transparence globalisée. Revendiquer un droit à l’opacité est non seulement une condition de survie des diversités culturelles ; c’est aussi une condition préalable au droit de reformulation évoqué plus haut. Même si un effort constitutif de l’université est d’expliciter nos pratiques, de les soumettre à la lumière de l’analyse critique et donc de fournir la base de nouveaux protocoles qui nous aideront à maîtriser l’infinie diversité du réel, ce travail d’explicitation n’est lui-même possible que par le maintien de certaines formes d’opacités locales, qui nous protègent de l’imposition des paramétrages obsolètes accompagnant toute imposition de transparence.
3. Revendiquer un droit à l’équivoque. Avec l’anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro, on peut enfin revendiquer un droit à l’équivoque, qui est lui aussi une condition de survie des diversités culturelles et des dynamiques d’enrichissement mutuel auxquelles ces diversités donnent lieu. Contre les procédures de programmation qui nous imposent des choix exclusifs et binaires (0 ; 1), il faut affirmer que la plupart de significations que nous tirons de nos expériences du monde sont constitutivement équivoques. La même réalité peut être susceptible de descriptions apparemment contradictoires entre elles mais néanmoins également valides, du fait qu’elle est observée à partir de pertinences et de pratiques de natures différentes. L’équivoque ne relève donc pas d’erreurs à éradiquer, mais de diversités à cultiver. Les pratiques artistiques, qui cultivent activement ces équivoques, et les pratiques scientifiques, qui cherchent à les réduire, ne sont pas à concevoir comme exclusives mais comme complémentaires. C’est seulement dans les équivoques exprimées par les Humanités que les sciences dites « dures » puisent la pertinence de leurs recherches. Même si le dynamisme propre à l’entreprise scientifique repose sur la volonté farouche de traquer et de réduire les équivoques autant qu’il est en notre pouvoir de le faire, un scientisme visant à abolir les équivoques ‒ sans reconnaître leur nécessité propre ‒ est aussi oppressif pour la recherche universitaire que l’imposition de programmations pré-paramétrées ou d’un impératif intégriste de transparence.
Reformulation, opacité et équivoque constituent le pendant de l’errabilité inhérente à toute pratique instauratrice, qu’elle soit d’ordre artistique ou scientifique. C’est par tâtonnements intuitifs que l’amplification transductive propre aux recherches universitaires se développe à travers les champs du savoir. Si les universités se donnent pour mission d’explorer les virtuels en germe dans l’état présent du monde ‒ que ce soit dans le but de favoriser l’actualisation de ceux qui nous semblent souhaitables ou de prévenir celle de ceux qui nous paraissent funestes ‒ alors les Humanités doivent y jouer un rôle central. Leur fonction première est de questionner les protocoles et les programmes existants, afin de témoigner des disparations auxquels ils donnent lieu et afin de les ouvrir vers des reformulations plus fines, plus sensibles, plus intelligentes et plus puissantes ‒ autrement dit, plus respectueuses des charges de réalité contenues dans les opacités et les équivoques qui dynamisent nos pratiques.
C’est bien aux points multiples où les sciences rencontrent les arts que de telles universités appellent à être instaurées. Ce travail d’instauration d’universités nourricières de compétences à l’instauration exige, comme on l’a vu, une triple dose de liberté inventrice, d’exigence d’efficacité et d’acceptation de l’errabilité. Serons-nous à la hauteur de cette tâche ? Ni le génie individuel, ni la Bohème artistique, ni la course aux profits capitalistes ne suffiront. L’avenir des universités repose sur la difficile et patiente constitution de collectifs susceptibles de porter un tel espoir.