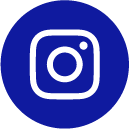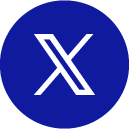Évocations antiques
Il est un élément du passé qu’il est impossible de mettre au jour, et qui constitue une donnée fondamentale du cinéma et de l’audiovisuel : le son. Ainsi, les sons du passé sont une « arlésienne » : ils brillent par leur absence, tout comme la Vénus d’Arles, cette statue antique découverte en 1651 dans le théâtre antique de la ville, est à la fois omniprésente dans l’imaginaire arlésien et « réellement » absente (elle est au musée du Louvre). Une arlésienne, aussi, au sens où la statue fut la matrice du « mythe de l’Arlésienne », faisant entrer la Vénus dans l’arbre généalogique des Arlésiennes contemporaines, selon une filiation fonctionnant comme indice de la beauté des femmes d’Arles. Articulée à la question sonore, l’image de Vénus ouvre aux dialectiques présence/absence et passé/contemporain, tout en suscitant des questions sur les représentations de la féminité et des regards portés sur elles (male gaze/female gaze).
Il s’est donc agi de travailler avec et sur les clichés hérités de l’Antiquité. La donnée archéo-acoustique (l’absence des sons de l’Antiquité) s’articule à une interrogation sur les variations de regards sur la féminité, à même de faire surgir de nouvelles images et sensibilités. Vénus devient alors une formidable figure critique pour penser notre époque et ses représentations.
Vénus (mythe, cliché, féminité)
Qu’une statue de marbre antique puisse apparaître comme la matrice de femmes contemporaines n’a rien d’étonnant : les découvertes archéologiques des copies romaines d’originaux grecs ont informé les représentations modernes de la féminité et de la virilité, comme le montre George L. Mosse dans L’Image de l’homme. L’invention moderne de la virilité (1997). Les représentations filmiques se construisirent à leur tour sur ces fondations, le star système hollywoodien poursuivant, souvent explicitement, l’analogie entre les déesses de l’écran et leurs ancêtres mythiques et sculpturales (M. Williams, Film Stardom and the Ancient Past : idols, artefacts and epics, 2017). Il n’est pas anodin que ce médium, parent de la photographie, art de la reproductibilité technique, et donc de la circulation mass-médiatique des représentations, ait aussi partie liée avec la circulation des clichés, des stéréotypes de genre.
C’est justement ce qui a intéressé ce workshop : travailler avec et sur les clichés, au sens photo-filmique et au sens culturel. Avec et sur les clichés hérités, ou plutôt construits, sur certaines interprétations et manipulations de l’Antiquité. Le point de départ sonore (ou archéo-acoustique), à savoir l’impossibilité de mettre au jour les sons de l’Antiquité, nous a donc particulièrement intéressés pour ces implications épistémologiques et théoriques (les conditions d’accès au passé), esthétiques (les modalités de la sensibilité et de la perception, l’(in)visible, l’(in)audible), narratives (le mutos, le récit, le storytelling), politiques (les manipulations présentes du passé) et créatives (le jeu de l’imagination et de la fiction). Mais, on le comprend, ce point de départ s’est prolongé, dans cette nouvelle session de l’atelier, par une interrogation sur les variations de regards portés sur la féminité et ses représentations, à même de faire surgir de nouvelles images et sensibilités occultées par les clichés. Pour reprendre une citation de Fellini : « L’Antiquité n’a peut-être jamais existé, mais il ne fait aucun doute que nous en avons rêvé. » Sur le plan sonore et visuel, Vénus devient alors un formidable outil critique, ou plutôt une figure critique, pour penser notre époque et ses représentations – avec toutes leurs latences et leurs hors-champs.
Sur les pas
Le workshop a ainsi consisté à aller « sur les pas de Vénus », ce qui s’est décliné de nombreuses manières, en autant de propositions créatives et de formes artistiques susceptibles de déconstruire les représentations de la féminité induite par la déesse, de la recherche de la trace de Vénus dans les vestiges antiques à des essais de mise en scène en studio.
Dans la perspective d’un workshop de recherche-création, aller « sur les pas de Vénus », ce fut engager un travail articulant une pratique de terrain (marcher, déambuler pour enquêter), des enjeux de création (la démarche – protocole, méthode – mise en œuvre) et des questionnements scientifiques (la circulation des représentations, entre reprises, imitations, stéréotypes, routines et sentiers battus d’un côté, et les voies de traverse, le hors-piste et les passages secrets de l’autre).
Déroulement
Les étudiant·es ont été réparti·es en 6 groupes de 2 ou 3, associant chacune des formations de master concernées par lʼatelier et un site a été attribué à chaque groupe. À partir de là, lʼenjeu était dʼarticuler une pratique de terrain (prise de vue – en images fixes et/ou animées – et prise de son sur sites), la formalisation dʼune proposition narrative et un travail de réalisation (montage, postproduction). Des conférences, master class et ateliers pratiques animés par des professionnel·les ont rythmé lʼatelier. Il sʼagissait également, à la fin de lʼatelier, de présenter le prototype audiovisuel réalisé lors dʼune restitution publique.
Six films dʼenviron 5 mn chacun ont été réalisés : Canten Venus (Alyscamps), La Reine dʼArles nʼest pas blanche (arènes), Tierce (cryptoportiques), Iʼm not your Venus (théâtre antique), Vos yeux me numérisent (museon Arlaten), La Fresque (Musée départemental Arles antique). Ils ont été présentés et projetés dans lʼauditorium de lʼENSP, en présence dʼun public dʼenseignant·es, artistes, étudiant·es, de la direction du Musée départemental Arles antique et de la direction du Museon Arlaten.
Les films sont disponibles en libre accès sur Vimeo.