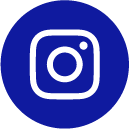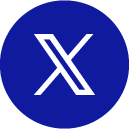L’expérience cinématographique du visage
Date
23/05/2025
Lieu
Salle A2 203 maison de la recherche université Paris 8
Infos pratiques
14h30
Les étudiant·es du master ArTeC ayant participé à l’atelier « L’Éxpérience cinématographique du visage » (encadré par Fabien Boully, Aurore Mréjen et Andra Tévy) présenteront les projets réalisés le vendredi 23 mai à partir de 14h30 en salle A2 203 de la Maison de la recherche de Paris 8.
La question des relations entre visage et cinéma n’est pas nouvelle. Les réflexions, par exemple, de Louis Delluc et de Jean Epstein sur la photogénie – cette « qualité poétique ou esthétique d’une personne ou d’un objet révélée et amplifiée par le cinéma » (Delluc) – se sont accompagnées d’une poétique du visage, site par excellence de cette insaisissable photogénie, qui pourtant s’impose au regard. Gilles Deleuze a consacré des pages mémorables au visage comme image-affection, car « l’image-affection, c’est le gros plan, et le gros plan c’est le visage… » Jacques Aumont, quant à lui, a consacré un ouvrage entier, Du visage au cinéma, non pas tant à la représentation du visage au cinéma qu’au problème de savoir ce que la représentation cinématographique fait du visage, entre sublimation et défiguration. Le cinéma, de fait, offre une expérience du visage qui dépasse la question de la représentation. Cela tient au rapport au visage, comme rencontre avec l’altérité, au-delà de toute fixation dans une forme définissable. Pour Emmanuel Lévinas, la transcendance de l’autre ne peut être appréhendée que par l’éthique, la responsabilité infinie qui m’incombe à son égard, et non par la représentation sensible. L’étrangeté d’autrui repose sur son insaisissabilité et son visage ne peut être décrit. Son apparition dépasse tous critères visibles. La vision ne permet pas d’accéder à sa transcendance dans la mesure où elle tend à le limiter à la forme à travers laquelle il se présente. Autrui excède toute description possible.
Au cours des séances de séminaire, plusieurs problématiques auront émergé, de natures assez différentes : le visage indescriptible/insaisissable ; la « normalité » du visage (entre figuration et défiguration) ; le visage avec ou sans son ; le gros plan/l’hyper-gros-plan ; la mise en relation des visages ; la distinction entre face/profil/trois-quart… C’est à partir de ces questions que six projets auront été réalisés, dont nous pourrons découvrir les visages lors de cette restitution.
Un moment convivial suivra les présentations de l’atelier.